
Il y a le masque, bien sûr. Se conformer, se cacher pour être acceptée. Pour ne pas faire de vague, parce que c’est ce qu’on a compris de la vie. C’est ça la vie : on s’adapte, on joue le jeu. On est pragmatiques.
Et puis se livrer aux autres, c’est compliqué. Dangereux pour moi et pour eux. Décevant, parfois.
2012. Je suis au lycée, première, terminale. Je ne vais pas très bien, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Plutôt, je sais que je ne veux rien faire. Rien ne me fait envie. J’ai perdu toute substance, tout enthousiasme de l’avenir – honnêtement, je n’en ai jamais eu beaucoup. Je vis dans l’observation et la rêverie, j’aime les livres et les mouvements de la lumière qui se reflètent dans l’eau. J’aime imaginer une vie qui ne se produira pas, faite d’errance, de fuite et de liberté.
Depuis petite, je veux fuir le cadre dans lequel j’ai appris à m’intégrer, auquel je m’adapte, car il me fait profondément ressentir que la vie n’a pas de sens.
Malheureusement, je généralise. Ce n’est pas cette vie, cette société, ces injonctions à la productivité ou à la réussite scolaire qui n’ont pas de sens. C’est tout. Nous sommes d’infimes particules dans un univers. Je suis un tas d’atomes, à seize ans, j’écris : « comme le tapis de la salle de bain ». Je suis là, allongée sur le fameux tapis, hors du rythme du dehors, espérant que l’instant suspendu soit infini, et pourtant je souffre aussi seule. Le monde réelle a trop d’emprise, il m’a trop persuadée que mon monde intérieur non plus n’a pas de sens.
Je ne vaux rien. Pas parce que je suis minable – quoique dans un sens… – mais parce que ma vie ne vaut rien. Parce que je ne suis qu’un tas d’atomes à la machinerie complexe, mais appelé à devenir un autre tas d’atomes. Je suis tout et rien. Tout parce que je suis faite du tout, et pourrais en être chaque partie. Je pourrais être le soleil ou le tapis de la salle de bain. Tout. Rien parce que le tout n’est rien. Il est appelé à disparaître, se transformer, se ré-assembler. Le tout est aussi fragile et changeant qu’une bulle de savon, et une bulle de savon n’est rien d’autre que le tout, qu’un tout, ou peut-être rien. Et je n’ai à être rien, ou ai à n’être rien. Me parler, me définir en tant que personne, que tout et non partie du tout, me demander si je suis, ou puis être, moi-même semble – est ? – une ineptie. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Comme tout. Toutes les parties du tout. Mais je ne marcherai jamais dans la vallée de l’ombre de la mort. Parce que je n’existe pas.
15 avril 2012
J’écris. Je me détache du réel tout en en ressentant la pression, si forte, les gens, que malgré tout j’aime, que du moins je ne veux pas attrister ou heurter, semblent loin mais omniprésents. Je vis selon les règles du monde des autres. Les centaines de livres que j’ai lus, déjà. J’ai une théorie vaste et complète du monde, qui ne me rend pas heureuse.
Je me soucie des gens, tout en me disant que rien n’a d’importance, que tout lien est cynique, égoïste, qu’on n’aime chez les autres que le sentiment qu’ils évoquent chez nous.
Mes sentiments sont si flous, si inaccessibles à moi-même que je doute même d’être capable d’aimer, de ressentir quoi que ce soit.
Et j’ai peur d’entraîner les autres dans ce marasme.
Été 2012. J’ai quinze ans, je suis fascinée par Arthur Rimbaud. Rilke, Poe, Verlaine. Les jeunes hommes homosexuels rejetés par le monde et la famille. La solitude. Le mal-être adolescent. Je lis, je regarde des films sur le sujet. Sur la solitude et le fait de ne pas trouver sa place.
Le plus souvent, dans les films, dans les livres, ils finissent par trouver.
Je suis jalouse de leur intensité, de leur connexion à leurs sentiments. Ils sont perdus, rejetés, mais ils savent ce qu’ils aiment.
Je fais des choses et je ne suis plus sûre de les aimer, qu’elles me font du bien. Je lis et j’écris, je regarde la télé. Tout ça me semble une distraction écoeurante, une façon d’ignorer l’inanité du reste. La seule grandeur qui reste est la souffrance, l’histoire écrite par les poètes maudits. Alors j’écris, sans un sourire sur les lèvres.
Et comment partager ça ?
J’ai si peur de l’impact sur les autres.
Je vois mes amies s’envoler vers le début de l’âge adulte, choisir des voies, avoir le cœur brisé par des amours adolescentes, par des querelles avec leurs parents. Je ne comprends pas vraiment, je me sens si inaccessible à tout ça. Je suis un boulet, qu’elles se traînent au pied parce qu’on se connaît depuis trop longtemps.
Je tente de partager mes mots avec des inconnus, sur Facebook. Quelques j’aime, quelques commentaires, mais rien qui me connecte vraiment. Je n’ai pas la force d’aimer l’échange, de lire les mots des autres en échange de leur participation aux miens.
Je tente de partager mes mots, parfois, à mes proches. Il me faudra bien des années encore avant d’oser les partager avec mes parents – car à quel point je sais que ce n’est pas leur faute, et que personne ne peut m’aider !
Quelques textes sont lus, mon cœur bat, j’ai peur de les contaminer, peur d’être rejetée. Ma souffrance est une sorte de faiblesse mais surtout une grandeur. Mes mots sont sublimes et justifient tout, doivent tout justifier.
On les remarque. On complimente mes phrases. Sans commenter la souffrance. En disant que c’est dur, triste, affreux, illisible de souffrance.
Mais qui me sauvera ?
Qui saura tout de moi ?
Qui sera assez fort pour lire tout ça, et pour savoir ce qui ne va pas chez moi, comment m’aider ?
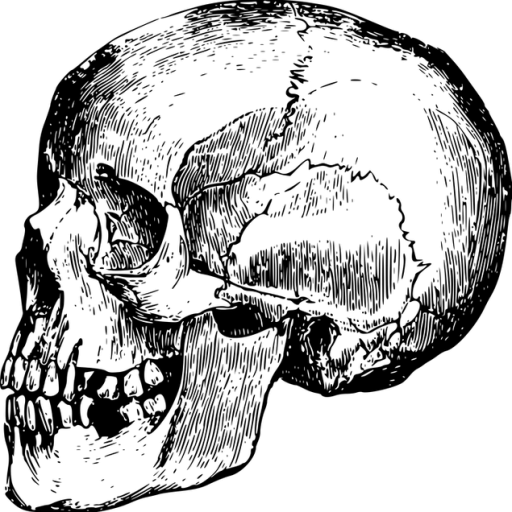




Laisser un commentaire