À l’occasion des vacances, je vous propose le premier chapitre de mon livre, Splendeurs et misères de la Mort. Je vous serais très reconnaissante si vous vouliez laisser un avis 🙂
Voir l’article
To die, will be an awfully big adventure
J. M. Barrie, Peter Pan
Victor
Mardi. La Mort rend visite à Victor à l’hôpital. L’hôpital pour enfants, le plus grand de la ville. Victor est malade depuis longtemps. Il sait qu’il va mourir, il ne sait pas pourquoi. Il a neuf ans.
C’est un jour comme la Mort les aime, un mardi matin froid et lumineux. Les feuilles tombent des arbres, les autres enfants sont retournés à l’école. L’été est terminé, et les anciens amis de Victor ont depuis longtemps cessé de venir le voir. Leurs parents, surtout, trouvent le garçon morbide. Avec sa maigreur maladive et son crâne déserté, ces cernes profonds et son petit air d’en savoir un peu trop sur la mort. Non, ils ne peuvent pas laisser leurs enfants lui tenir compagnie. Le cancer, c’est peut-être contagieux, et leur précieuse progéniture est bien trop jeune pour voir un de leur camarade se décharner et mourir.
Ils ont peur, surtout. S’ils restent trop longtemps dans l’hôpital, ils auront l’impression de ne plus jamais pouvoir en ressortir. Ils ont peur de savoir à quel point la vie est fragile. Même la vie d’un enfant.
La Mort apprécie, elle admire ces morts d’enfants. Victor est calme et compréhensif, mais pas triste ou résigné comme peuvent l’être les adultes. Il n’y a rien de petit ou de facile dans sa mort, et il la voit arriver avec un sourire sur les lèvres. Les enfants ressentent bien mieux les émotions sublimes : ils ne cherchent pas à les comprendre. Ses pensées sont simples, il a un peu peur. Ses parents sont dans un plus triste état. Mais, bien sûr, eux doivent survivre, et ils ne peuvent rien faire pour leur fils. Et la Mort sait bien qu’ils survivront. Beaucoup de parents prétendent qu’ils ne pourront pas vivre sans leur enfant, mais bien peu ont vraiment le courage de se supprimer. Ils continuent à vivre, comme lestés, grisés, et dans chacun de leurs éclats de rire résonne une culpabilité trouble et cruelle.
Ils ont encore une fille. Victor a tant aimé sa petite sœur, la petite Camille, qui n’a que cinq ans. Elle ne comprend pas tout, et ses parents ne l’emmènent pas souvent le voir, ils ont peur de la traumatiser, ils veulent la protéger, elle leur en voudra dès qu’elle sera en mesure de les détester. Victor manque à Camille, elle aimait tant jouer avec lui, se battre pour faire semblant, rire et crier dans la maison. La dernière fois qu’ils ont joué, il était le prisonnier et elle la policière, et les simples menottes en plastique lui ont laissé des marques violettes et noires, immanquables, sur les poignets, pendant des semaines. Après cela, ils n’ont même plus eu le droit de jouer autrement qu’assis, l’un en face de l’autre, colorier ensemble des ciels bleus de printemps que Victor ne verra plus.
Catherine, la mère de Victor et Camille, a arrêté de travailler depuis que Victor vit en permanence à l’hôpital. Elle se cache dans la salle de bain pour pleurer, et Victor le voit bien. Elle vient tous les matins, elle est venue ce matin comme tous les autres. Elle ne sait pas que ce sera le dernier, mais les médecins ont cessé d’essayer de lui donner de l’espoir. C’est la phase où il faut la préparer. Bientôt, Camille sera fille unique.
Parfois, la Mort observe que les frères et sœurs des enfants qui meurent se considèrent ensuite comme des enfants uniques, que les parents cessent de répondre qu’ils ont deux enfants, ou trois, ou quatre, lorsqu’ils cessent de les avoir. Et parfois, ils n’abandonnent jamais, ils continuent à se battre pour leur statut de parent, leur statut de petite sœur. La vie est compliquée, quand on perd un frère ou une sœur quand on est encore enfants. Les parents souvent se séparent, se retirent de la vie, en les observant survivre la Mort voit des suites infinies de journées tristes, comme si tous les jours étaient des jours de pluie, comme si, comme dans les films, une musique triste se répandait dans toutes leurs pensées. Et parfois ils arrivent à oublier un instant, parfois même des minutes, des journées entières, et ils doivent ensuite porter le chagrin de la perte, et la culpabilité d’être malgré tout heureux.
Certains refont des enfants, s’ils ne se séparent pas, comme pour annuler le sort. Souvent, quand les enfants mouraient, dans le passé – comme il y en avait alors ! -, les parents nommaient l’enfant suivant comme celui qui l’avait précédé. Une vie pour une vie. Certains étaient si habitués, si vidés des grossesses successives, des maladies ou de la faim, qu’ils ne souffraient même plus de les perdre.
D’autres, pourtant, perdaient les uns après les autres des bébés, des enfants, de jeunes adultes qui déjà étaient une promesse d’avenir, et souffraient chaque fois, souffraient parfois de ne pas souffrir pareillement de chaque perte. La Mort se rappelle cette mère qu’elle a vue perdre coup sur coup quatre de ses six enfants, lors d’une épidémie de grippe. À chaque nouveau petit cadavre qu’elle trouvait froid dans un lit commun de plus en plus vide, elle éprouvait de la douleur, mais surtout un immense soulagement de n’avoir pas perdu Sylvère, et une peur encore plus grande de le perdre à son tour. Sylvère, son enfant préféré, son dernier, la prunelle de ses yeux, celui qu’elle avait failli perdre en couches, qui avait seul les yeux clairs de son père disparu, et qui avait toujours pour elle une petite attention qui lui réchauffait le cœur.
Tant d’histoires. Les femmes soulagées de la mort d’un enfant, né ou non. Les pères partis, dévastés, indifférents. Ceux dont le soulagement de pouvoir réessayer pour faire un garçon cachaient mal la peine de perdre leur fille.
Des histoires. Des destins. Des coïncidences qui font de beaux récits, qui font des drames humains ou des réussites formidables.
La Mort est une esthète, une intellectuelle, elle aime observer ces histoires, ces consciences qu’elle a pu voir s’éteindre, les cœurs contents ou éplorés qu’elles laissent derrière elles. Les conséquences, les déchirures dans la vie des gens, l’horreur de ceux qu’on oublie aussitôt. Ces gens de toutes sortes, de toutes qualités, des grands, des petits, des vieux et des enfants, des bons et des monstres. Elle est fascinée par les gens, elle est fascinée par la cessation de leur vie. Elle est fascinée par les histoires qu’ils inventent pour avoir moins peur, par les images qu’ils ont d’une Mort faucheuse et cruelle, par la manipulation et les interprétations qu’ils font de ces images. Elle l’est aussi, parfois. Elle est fascinée par les émotions qu’ils connaissent, qu’elle vit à travers eux, ces émotions qui se répètent, si semblables, depuis la nuit des temps, et que pourtant elle vit de façon nouvelle à chaque personne qu’elle accompagne, à chaque vie qui s’interrompt, à chaque famille qui se brise. Elle se remplit de leur vie et de leur mort, se fond dans leurs expériences, dans leurs peurs parfois, dans leurs sensations de sublime, d’extase, leurs occasions d’être forts et magnifiques, d’autres fois. Chaque mort est comme une œuvre, une œuvre d’art, un prisme d’émotions, qui se réalise sans même qu’elle ait besoin de l’imaginer. Elle n’abat pas la faux : les gens meurent, c’est tout ce qu’ils savent faire.
Mais elle est là, chaque fois, pour recueillir les derniers moments, les dernières émotions. Si vastes, si fortes, si affreuses ou si paisibles.
Voir comme Catherine se délite, s’efface, se replie dans sa souffrance pour la vivre pleinement, alors que Patrick, le père de Victor, ne montre que peu d’émotions, n’en ressent que peu, également. Il ne s’attarde pas dessus. Il n’accepte pas, n’envisage pas la mort de son fils. Il ne l’envisagera pas tant qu’il ne sera pas effectivement mort. Alors il ressentira. Catherine sera brisée. Patrick sera furieux. Une rage sans visage et sans objet, envers un destin aveugle auquel il ne croit pas. C’est la faute à pas de chance, la poisse, la guigne, et c’est son enfant qui doit mourir !
Mais la Mort sait qu’elle n’est qu’un autre nom du hasard. Et du destin. Le monde est un théâtre, elle en est le spectateur, l’amateur surtout, le monde est magnifique, les émotions sont magnifiques. Semblables, différentes, puissantes, violentes, atténuées, effacées. Elle se repaît des émotions et des histoires, des consciences. Le monde est un spectacle, parfois elle ne sait plus même si elle le crée, l’influence seulement, ou même le regarde impuissante. Mais elle l’aime, ce spectacle, il la fascine, puissamment, les émotions les plus vives la rendent un peu plus vivante, un peu plus proche des hommes, des animaux, de la nature, du système dans lequel elle évolue. Et pourtant, ils sont si inaccessibles dans leur douleur, dans leur colère, dans leur soulagement, dans la joie sauvage qu’ils éprouvent, parfois. Elle souffre parfois avec eux. Mais, le plus souvent, ils ne sont que des histoires magnifiques, subtilement hors de portée.
☼
Pour les cas comme Victor, les morts à l’hôpital, les longues maladies, l’œuvre est un roman fleuve, un feuilleton en multiples épisodes, une langueur qui s’installe, se prépare, se magnifie. Les émotions se déploient. S’atténuent, se renforcent. Tout en nuances et en paroxysmes, en torture lente et en résignation, en bonheurs profonds aussi. C’est dans ces fleuves qu’on se débat, qu’on réfléchit, qu’on arrive, qu’on se dévoile. Qu’on se noie, parfois. La Mort passe un temps infini avec Victor, avec ses parents, sa famille, ses amis. Dans chaque tête à la fois, vivant les émotions de chacun d’eux. Une cacophonie grisante de pleurs, le soulagement des autres parents qui imaginent en le voyant leur propre enfant, la jalousie des camarades à qui l’on accorde moins d’attention, l’incompréhension frustrée de Camille, qui soudain est davantage choyée tout en étant négligée. Ses parents ne lui parlent presque plus, mais chaque soir ils la serrent longuement dans leurs bras, comme pour conjurer le sort. Ils ne lui expliquent rien, mais ils la couvrent de cadeaux, lots de consolation anticipés, signant une défaite qu’elle ne comprendra pas avant longtemps. La Mort aime les émotions enfantines. Cette pure confusion convaincue, ces certitudes à côté de la réalité, ces assertions catégoriques qui font sourire les adultes. Ces pensées franches, comme venues de nulle part, non contaminées par la vastité du carcan qu’un esprit apprend, et s’impose, peu à peu, en grandissant.
Victor est comme tous les enfants mourants. Rendu grand par son statut. Rendu sage. Ses grands yeux grand ouverts, quelquefois la Mort jurerait qu’il la voit, qu’il la toise, il la cloue de son regard rougi et agrandi par la chimiothérapie et l’absence de ses cils. Il a dû réfléchir à la mort avant la plupart des jeunes de son âge. Il a senti le vide immense et la solitude absolue de celui qui contemple en face la réalité de sa propre mort. Ce sentiment qu’on ressent quand on imagine pour la première fois que le monde existera sans nous un jour, qu’il continuera à tourner, et que sa conscience en sera absente, sans pouvoir le savoir. Ne plus avoir conscience. Avoir disparu, pour toujours et à jamais. Victor n’arrive pas à imaginer totalement que sa raison, sa tête vont s’évanouir. Quand il y pense, il imagine ses pensées décrochées de son corps, flottant dans l’espace immense. Tout est bleu foncé, il se fait la même idée de l’espace, dans la nuit, il voit des étoiles au loin, de sa conscience ne subsiste guère qu’une pensée, qui n’en est même pas une : son champ de vision seulement, il comprend, profondément, obscurément, qu’il n’existera plus, mais cette imagination du vide ne peut s’affranchir de la vision du vide, de cette cage cognitive que sont ses orbites. Il pense derrière ses yeux. Il n’arrive pas à penser qu’un jour, il n’aura plus rien pour voir, ses yeux se seront racornis et desséchés dans ses orbites, les connexions neuronales qui lient ses yeux à son cortex visuel auront pourri, il ne restera que les yeux de ses proches pour pleurer.
Lorsque la mort l’emporte, Camille est venue voir son frère. Patrick travaille, et Catherine éreintée est allée chercher du jus d’orange pour ses enfants, ou au moins pour Camille. Victor a de plus en plus de mal à déglutir. Mais il est encore là, encore conscient, il se voit mourir, il se sait mourir. Catherine n’est pas là, Patrick n’est pas là, les enfants sont seuls dans ce monde merveilleux des enfants, Camille raconte l’école à son frère, tout excitée, et Victor sourit, il oublie qu’il va mourir, que l’école, c’est fini pour lui. Ses paupières sont lourdes et le babil de sa petite sœur l’endort. Il croit s’endormir. Camille parle, parle, souvent elle parle à ses parents et ils ne l’écoutent pas, alors elle parle sans s’arrêter, pour en sortir le plus possible, même lorsqu’elle voit que les yeux de son frère se sont fermés. Victor entend encore, un peu, il s’enfonce dans une douce quiétude, il ne pense plus à rien, bercé par sa sœur et par son affection pour elle, il s’endort dans une dernière connexion neuronale qui lui dit “mignonne”, “confort”, il s’endort, il meurt.
“Et la maîtresse, après, elle a dit que je savais presque lire, et on a collé des gommettes, et j’en ai gardé pour Monsieur Ours, je pourrais t’en donner, si tu veux, on les collera sur ta blouse, et sur la poche, là, …”
☼
Comme la Mort le pensait, Catherine se sent coupable, et soulagée, et coupable de se sentir soulagée. Elle n’était pas là. Lorsqu’elle est revenue avec deux jus d’orange, pour faire croire encore à une normalité, Camille pépiait, racontait sa vie à son frère. Elle le ferait encore, des mois, des années, désormais Monsieur Ours et Victor ne feraient qu’un pour elle, elle leur parlerait. Catherine n’a pas compris, en entrant dans la chambre, elle a tendu son jus d’orange à Camille, a posé le second sur la tablette à côté du lit, elle s’est assise à côté de sa fille. Elle l’a prise dans ses bras, et Camille, tout à sa boisson, s’est tue un instant. Catherine a regardé son fils, le sentiment de déchirure et de désespoir, dans son cœur depuis presque deux ans, un peu moins aigu qu’au début, mais toujours installé. Elle l’éprouvait à tout moment, à tout instant, elle n’arrivait plus à s’en déparer, à s’en divertir, elle ne pouvait plus travailler, plus rire, elle y pensait tout le temps. Et quand elle n’y pensait plus, quand il lui arrivait, rarement, de se laisser gagner par un rire, il revenait aussitôt, accompagné de son amie la culpabilité, et c’est eux qui riaient, ils riaient d’elle.
La Mort, elle, n’a pas le cœur à rire. Catherine regarde son fils, le désespoir présent, encore plus fort chaque fois qu’elle le regarde, qu’il est sous ses yeux, il n’y pas d’échappatoire quand elle le voit. C’est un mal nécessaire. Une partie du plan. Une magnificence, seule la douleur est si forte, si belle, la douleur, et les autres émotions que la mort provoque. La profondeur du vide, l’immensité du plein des émotions absolues, la mort seulement les provoque. Et Catherine regarde son fils. Il est pâle, ses cernes sont marqués, ses os ressortent, saillants sous sa peau, jaillissant de sa blouse, le seul vêtement qu’elle l’a vu porter en sept mois. Il avait les cheveux bruns, il ne lui reste que quelques cheveux, fins comme ceux d’un bébé, qui commencent à repousser. Depuis qu’ils ont renoncé, depuis qu’ils ont admis que la chimiothérapie n’avait plus de chance de réussir, depuis qu’ils l’ont abandonné à son sort de cas désespéré. Derrière ses paupières, il a de grands yeux marron, quelconques, mais qui étaient si lumineux, avant. Quand il n’était qu’un enfant comme les autres. Son monde, sa famille. Catherine se souvient de lui bébé, de lui enfant, de lui jusqu’aux sept ans terribles où le cancer s’est déclaré. Il avait mal à la tête, il était faible, personne n’avait rien vu venir. Et c’était injuste, si injuste, à en hurler, à en pleurer, quelle importance maintenant, pourquoi vivre si c’est pour perdre son enfant !
Catherine regarde son fils. Perdue dans ses pensées de lui, elle en oublie tous les mauvais moments s’ils ne sont pas liés au cancer. Oubliées les bêtises d’enfants, les coliques, les colères, oubliés les instants difficiles, les caprices et les pleurs, oubliées les humiliations, les questions des autres, les interrogations sur soi. Son fils meurt, elle en devient mère pleinement, elle n’a plus de doutes, plus de regrets, elle ne se dit plus que peut-être Patrick et elle auraient dû attendre de finir leurs études, d’être plus stables financièrement, ou de se marier. En perdant son enfant elle devient mère, ses sentiments rejoignent les discours qu’elle entendait partout en se demandant si, parfois, certaines mères regrettaient, voulaient retrouver leur vie, un seul instant, une seule soirée, pour être libres encore.
En perdant son enfant elle sait qu’elle ne sera plus jamais libre, elle en est si persuadée, comme si un rideau s’était déchiré pour atteindre la connaissance de soi, elle est mère, elle sera orpheline de son enfant, et c’est à peine si elle pense à sa fille qu’elle tient sur ses genoux. En le perdant elle n’est mère que de Victor, elle cristallise cet amour dont elle a parfois douté, tout en en étant parfois éblouie, désormais elle ne doutera plus. Fulgurance de la douleur, de la personnalité qui vacille. Qui se recomposera lentement.
Elle regarde son enfant, elle ne pense qu’à lui, mais elle ne pense qu’en elle, et elle n’a pas vu, pas encore, qu’il était déjà mort. La mort a officié, c’est écrit, elle n’a plus de fils. Elle n’a pas de mot pour cela. Ni veuve ni orpheline. Comment appeler le parent qui n’en est plus un ?
☼
Camille a terminé son jus d’orange. “Victor, Victor ! Tu veux ton jus d’orange ? Trop bon ! Victor ?”. Elle a pris l’habitude d’être grondée si elle essaie de monter sur le lit ou de toucher son frère. On lui dit toujours de faire attention, qu’elle va lui faire mal. Mais elle n’a que cinq ans, elle a oublié, elle se précipite, et renverse sur son frère le jus orange. Catherine est secouée, réveillée de ses pensées, le temps reprend, le temps s’arrête, elle a compris et ne veut pas comprendre, elle a le pressentiment vaste et froid, chaud et impitoyable, elle ne veut pas être sûre. Elle attrape Camille par les épaules, la tire en arrière, terrifiée sans savoir pourquoi, primairement, primalement. Elle voudrait que Camille s’arrête, une seconde, plus de mouvement, plus de bruit, plus de questions, plus d’attention à lui prêter, le calme pour retrouver un instant sa propre pensée. Elle regarde son fils, pâle, bleuté, les yeux fermés, les cernes vastes. Quelle pâleur diaphane, maladive, lui signale que quelque chose a changé ?
Camille s’agite, Catherine la serre, de plus en plus fort, elle enfouit son visage dans les cheveux de sa jeune fille, de la jeune fille unique, elle veut récupérer un instant de chaleur, de calme, de quiétude avant l’annonce, avant la mort.
Elle sait, elle ne veut pas savoir, elle appuie sur le bouton d’appel, incapable de voir elle-même. Elle ne veut pas être le médecin qui prononce, qui officialise.
Peut-on dire d’une mère qu’elle est orpheline de fils ?
☼
Hébétude, douleur, souffrance diffuse.
Douceur coupable du soulagement, terreur d’être soulagée.
Terreur de l’administratif, de la vie quotidienne, réelle, irréelle et nouvelle. Avis de décès, appel au père, appel aux grands-parents, aux amis, aux allocations familiales. Pompes funèbres.
Association de parents de cancéreux. Médecins. Infirmiers.
Remerciements. Fleurs. Décisions.
Une montagne, un fleuve de décisions, de choses à faire, d’obligations immondes, partout, mur face à Catherine, qui ne veut plus qu’attendre que le temps passe. Que le temps cesse.
La Mort connaît bien cette douleur, elle l’a vécue mille fois, dans mille consciences. Pourtant, la vie redeviendra normale, peu à peu. Le souvenir de la mort sera intermittent, comme un remord, comme une mauvaise conscience. Le souvenir de Victor sera une nostalgie, un pincement au cœur, une absence. D’abord ils seront toujours tristes, leur vie sortie brusquement de ses gonds.
Les émotions normales n’auront plus court. Les petites vexations, les petites joies, toutes englouties dans l’immensité cruelle de l’anormalité, de la brusque déchirure de la routine.
Et puis la douleur deviendra routine. La douleur deviendra un bruit de fond, parfois remis à neuf, après un rêve, un événement, une pensée. Les madeleines seront amères, rapportant avec leur odeur l’aigreur de l’ammoniaque et de la mort.
Et puis la vie reprendra, la douleur intermittente deviendra une part de la vie, qui n’empêche pas d’être parfois joyeux, et parfois triste. L’inconcevable anormalité de perdre un enfant deviendra une histoire, qu’on raconte parfois, qu’on a besoin de raconter parfois, et de taire d’autres fois.
Les premiers Noël, les premiers anniversaires seront des commémorations, des occasions de souvenir. Et puis un jour, un Noël passera sans qu’on y ait songé, sans qu’on ait souffert. On se sentira coupable. Et puis d’autres Noël, ne pas y penser sera même positif. Les vieilles photographies seront des sourires doux-amers, comme une photo de classe de sa propre enfance morte, et de ce qui aurait pu être.
Camille montrera des photos de Victor à ses propres enfants, un jour. Ils ne s’y intéresseront qu’une minute, quand il aura fallu à leur mère des années pour les voir sans pleurer, des décennies pour réussir à y célébrer une joie du temps passé.
La Mort sera là, saisissant toutes ces émotions, tâchant, sans jamais atteindre un absolu succès, d’être toutes ces consciences, de vivre toutes ces pensées.
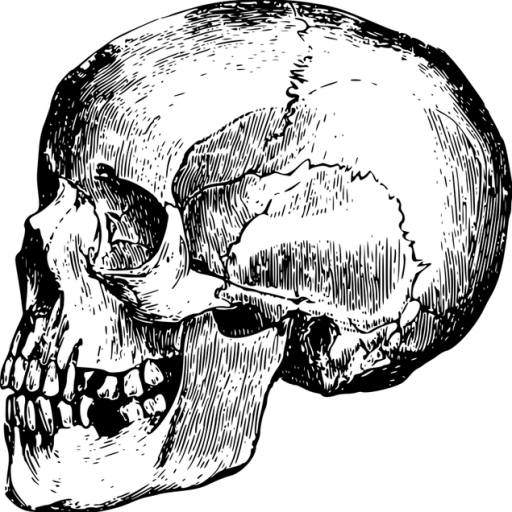




Laisser un commentaire