L’école républicaine française se base sur des idéaux méritocratiques. Elle nous raconte, tout au long de notre scolarité, que les bons élèves sont ceux qui travaillent bien, sérieusement, régulièrement. Qu’en travaillant avec les bonnes valeurs et la bonne implication, on atteint ses objectifs. On arrive en prépa, où on nous raconte qu’on est « la future élite de la nation » (histoire vraie. J’ai ri jaune, ce jour-là).

Sauf que je ne travaille pas comme ça. Je n’ai jamais travaillé comme ça.
Je ne sais pas si c’est le HPI, l’autisme, le TDAH que je soupçonne, mais je n’ai jamais été la gentille fille qui soulignait sagement ses titres, prenait ses cours proprement, écoutait sans trépigner sur sa chaise ou gribouiller dans la marge, qui travaillait « une heure tous les soirs en primaire, puis deux au collège« , et qui faisait son sac la veille au soir.
J’étais celle qui, globalement, écoutait en classe, qui gribouillait sur sa feuille, qui copiait ses leçons avec des fautes d’inattention, qui avait de bonnes intentions quant à la propreté de ses notes, mais finissait avec des dessins dans la marge, des ratures, une seule couleur. Celle qui regardait par la fenêtre, qui s’abîmait dans son monde, qui bâclait ses exercices pour faire des dessins. Dont on disait « au moins quand elle ne travaille pas, elle ne dérange pas la classe« . Dont on disait « se laisse entraîner dans des bavardages ». Qui a arrêté de faire ses exercices de maths à onze ans. Qui a écrit le nom d’un camarade, donné en exemple, au lieu du sien dans son cahier, le jour de la rentrée. Qui ne refaisait pas son sac. Qui oubliait ses affaires de sport dans l’entrée, après les avoir préparées et placées dans l’entrée pour ne pas risquer de les oublier. Qui ne participait jamais. Qui ne corrigeait pas les fautes des profs quand elle en voyait au tableau. Qui écrivait de tristes poèmes en marge de ses notes. Qui faisait des énigmes de math au lieu de travailler. Qui écrivait bien mais rendait parfois des torchons. Qui lisait au CDI au lieu de travailler. Qui ne fichait pas ses cours, ou alors la veille du contrôle. Qui ne revoyait pas chaque soir ses leçons (je ne suis pas persuadée que quiconque le faisait, à part en prépa). Qui ne relisait pas ses contrôles. Qui sortait, fuyait, dès qu’elle les avait finis, si c’était possible. Qui, sinon, dessinait sur ses brouillons en rêvassant. Qui a failli s’endormir à la fin de son TOEIC. Qui a commencé son projet informatique en douze semaine deux semaines avant le rendu, après s’être flagellée longtemps. Qui faisait tout d’une traite, qui détestait revenir sur un travail fait.

Qui avait de bons résultats, sans travailler. Sans travailler autant que les autres, sans travailler autant qu’on disait qu’il était nécessaire de travailler, sans travailler autant que l’avenir lui demandait de travailler, en entreprise.
On dit que les élèves comme moi finissent par se prendre un mur, tôt ou tard. En rentrant au collège, au lycée ou dans les études supérieures. J’ai eu peur chaque fois. Quand, en primaire, on m’annonçait que j’allais devoir, au collège travailler chaque soir et que je risquais des « contrôles surprises » à chaque cours, j’ai eu peur. Puis en entrant au lycée. Puis en prépa. Le premier jour, j’ai pleuré parce que c’était trop facile, trop pareil à ce que j’avais fait jusque-là, ennuyeux de la même façon. Ensuite, j’ai pris une sorte de mur, plutôt mou, d’autant plus que tout le monde s’y attendait. Avoir 12 de moyenne en prépa, être 5ème de sa classe, c’est plutôt une réussite. J’ai travaillé un peu, au début. Je fichais les sciences sociales et l’histoire, la première année. Je trouvais étonnamment facile de m’y mettre, le soir, et puis j’ai arrêté. En deuxième année, je prenais mes cours sur ordinateur, pour qu’ils soient moins brouillons et que je puisse les relire, même après les avoir enterrés pendant des mois.
En prépa et en école d’ingénieurs, j’avais des résultats relativement normaux, et même plutôt bons, selon les standards du supérieur, mais pas excellents. Mais je ne savais toujours pas travailler. Je faisais les choses à la dernière minute, apprenait mon vocabulaire pour les interros hebdomadaires de latin ou d’anglais entre midi et deux, révisait les devoirs annoncés des mois à l’avance la veille au soir. J’ai passé des vendredis soirs à faire des frises chronologiques sur les auteurs et les livres classiques, plutôt qu’à relire mes cours, car « c’est quand même de la littérature« .
À la fin de mes deux années de prépa, on m’a proposé de redoubler pour retenter les concours plus prestigieux que celui que j’avais eu (et ceux que j’avais eus et aux oraux desquels j’avais refusé d’aller). Honneur réservé à ceux qui travaillaient, qui « jouaient le jeu ». Camouflet final, preuve que le travail n’avait jamais été la valeur (j’avais dit au prof qui insistait que j’étais malheureuse en prépa, que je n’aimais pas sa matière, et que je ne fichais plus), mais les résultats bruts, immérités.
Et puis le travail. Pour la première fois, je n’avais pas de notes, mais des heures de présence à faire. Pas d’évaluations, pas de moyens de me prouver que je faisais illusion, à part une revue une fois par an. Mes supérieurs étaient satisfaits, relevaient parfois – rarement – un manque d’autonomie ou une tendance au silence. Sauf que des retours, une fois par an, c’est peu pour me sentir bien dans mon travail, alors que je travaille deux ou trois heures par jour. Alors que je passe plus de temps à réfléchir, à lire les actualités, sur Wikipédia, sur Bored Panda, qu’à travailler. Alors que je soupire à chaque mail reçu. Je fais mon travail. Pour une raison qui m’échappe, je ne suis jamais occupée à plein temps, dans aucun des emplois que j’ai, au fil du temps. J’apprends à m’occuper, je peine à gérer mon sentiment de culpabilité et d’ineptie, mais je peine aussi à me trouver du travail supplémentaire, à chercher de nouveaux challenges. Je me sens mal mais je n’ai pas envie d’en faire plus. Dilemme insoluble qui me fais échouer chez une psychologue, un psychiatre, une autre psychologue, puis encore une autre. On m’identifie un HPI, puis un TSA. Je lis les témoignages de ceux qui ne peuvent s’empêcher de travailler trop, de s’impliquer trop. Encore une fois, je suis décalée, et même décalée au milieu des décalés. Je suis en bore-out chronique. Refusant la contrainte, réussissant quand même. Je dis que je m’ennuie, on me promeut. Je veux partir, je suis démarchée pour une nouvelle opportunité clinquante.
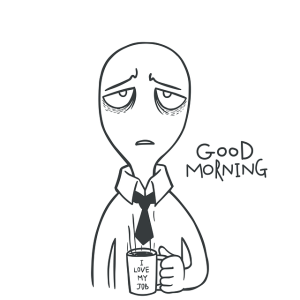
Je ne veux pas être celle qui se plaint de tout réussir, c’est ridicule et abject vis-à-vis des autres, de ceux qui travaillent, qui triment, qui donnent tout ce qu’ils ont.
C’est une culpabilité supplémentaire.
Je suis perdue.
Il ne me reste qu’à me pardonner, et essayer de trouver ce qui me convient vraiment. Ah ! Je cherche, j’ai des pistes, mais comme j’aimerais, une fois, que les choses soient simples, que mes contradictions aient du sens.
Je ne sais pas travailler huit heures par jour, l’école ne me l’a pas appris. Elle ne m’a pas appris non plus à réévaluer ma vision des choses, et à m’autoriser à juger mes résultats, pas mon temps de travail. À accepter mes facilités, à ne pas faire de mon travail une histoire de morale.
Parce que c’est comme ça. Ni moral ni immoral.
Ça ne me convient pas, c’est tout. Même si je conviens assez au monde du travail, il ne me convient pas.
Voir aussi :
La prochaine crise aura bien lieu : le rapport au travail
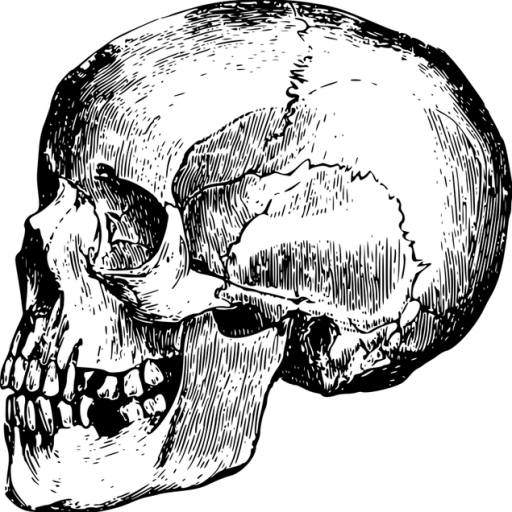




Répondre à Les troubles obsessionnels compulsifs et les pensées intrusives – Haut Potentiel d'Aventure Annuler la réponse.