En ce moment, je n’écris pas. Ni ici, ni mon roman en cours. Je crois que c’est la première fois en deux ans et demi que je loupe deux semaines de suite sur le blog.
Je suis fatiguée. J’ai du mal à me concentrer, j’ai une mauvaise mémoire, je rechigne à faire des choix (je vous ai dit qu’on était en train de refaire une maison ? Ouais, ça fait quelques choix à faire). Je dors mal. J’ai des vertiges, je prends du poids. Je ne suis pas créative : je me tourne plus facilement vers des loisirs « qui coulent tout seuls », qui ne demande pas de créativité ou de charge mentale : je regarde des vidéos, j’essaie de lire, au lieu de dessiner ou d’écrire je fais du diamond painting ou des jeux sur mon téléphone. Je me suis mise à la photo : ça nécessite moins de coordination et de « labeur » (à mon niveau d’absolue débutante qui joue avec son portable). Ne pas réfléchir.
Bien sûr, je sais à quoi ça ressemble, mais je ne suis pas à l’aise avec l’idée de burnout. D’abord parce que je sais que ça peut être pire, je le sais. Ensuite parce que je commençais à me dire que j’avais passé ma vie dans une sorte de pseudo burnout, en tout cas en masquant, en essayant d’être ce que je pensais devoir être. En plus, c’est difficile de jauger, de dire que je vais mieux ou moins bien qu’il y a quelques mois, quelques années, ou deux décennies.
Le point positif, c’est que ma fatigue ne se transforme plus automatiquement en tristesse. Adolescente, mes limites au quotidien, ma fatigue, ma lassitude étaient immédiatement interprétés comme des signes que la vie était absurde, que je serais toujours triste. La fatigue était une crise existentielle, et chaque fois que je me forçais à me lever, un de ces jours où c’était particulièrement difficile, il ne s’agissait pas de se battre contre une fatigue physique, mais de contrainte ontologique, et de la caractéristique même de la vie : la contrainte, le fait de me forcer. La mélancolie. Je me voyais comme un poète maudit.
Aujourd’hui, je me vois comme une neurodivergente dans une période vulnérable. Peut-être une neurodivergente qui ne devrait pas être étudiante à plein-temps, travailleuse à 80%, auteure occasionnelle qui aimerait écrire plus et Valérie Damidot à temps partiel ! Sauf que les projets, c’est cool. Ça donne du sens aux choses. Ça m’enthousiasme, un peu. Autant que je le peux. Et le travail, ça paye les projets !
Bref, en ce moment, je m’interroge sur celle que j’étais adolescente, sur la façon dont on se crée des systèmes de pensée qui encadrent le monde, potentiellement mal, faussement, tristement.
C’est comme ça la vie, il faut faire ce qu’on attend de nous.
Les émotions, c’est mal, et je n’ai de valeur que par mon intelligence.
J’ai le droit d’être bizarre, mais seulement si je correspond à telle image que je me fais – Dr House, Dr Reid, Dr Brennan, avec une touche de Mercredi Addams et de Rimbaud, peut-être. Mince, vous croyez que je dois me lancer dans un doctorat ?
Les projets me coûtent, ça doit être que je n’aime pas les faire.
Ce que je veux dans la vie me fait du mal.
Je suis indifférente. Je suis indifférente. Si, si, tout m’indiffère. Sauf en crise, mais les crises sont des faiblesses. Si je me blinde assez, si je dissocie assez, je n’aurais plus mal.
La vie est absurde.
Et aujourd’hui, avec quand même la petite voix qui dit que ce n’est pas plus vrai, plus assuré que mes schémas d’enfance et d’adolescence :
Je suis neurodivergente et donc vulnérable. Je ne pourrai jamais faire tout ce que je voudrais faire.
Je dois me laisser de l’espace, du repos, mais je ne suis pas à la hauteur de mes projets de vie en faisant ça.
Mais si, je suis juste une mauviette sans volonté, il faut juste se pousser. Regarde Amélie Nothomb, elle se lève à 4h, se force à écrire quatre heures tous les matins. Tu es trop douce avec toi-même.
Qui a dit que nos schémas intérieurs devaient être cohérents ?
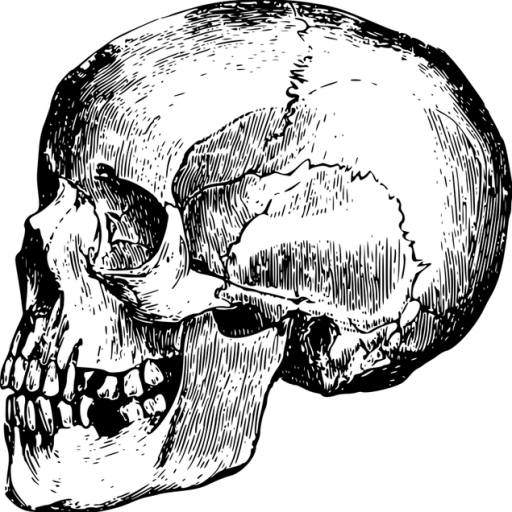




Répondre à dessinemoiunpoulpe Annuler la réponse.