On m’a dit toute ma vie que j’étais bizarre et intelligente : ni le diagnostic d’autisme, ni l’identification de mon HPI n’ont été une vraie surprise. Mais le TDAH, je ne l’ai pas vraiment vu venir. Je ne pensais pas vraiment souffrir de « paralysie », je ne connaissais pas les termes « dysfonction exécutive », je n’étais pas un enfant hyperactif. Je pouvais me concentrer, à l’école : je divaguais beaucoup dans mon monde intérieur, bien sûr, mais j’écoutais assez et retenait beaucoup pour avoir de bonnes notes.
Je pouvais tout faire : j’avais confiance en ça. Je procrastinais, bien sûr, mais je savais que je serai toujours à la hauteur, que je ferai le devoir « au talent » la veille du rendu, que j’irai plus vite que tout le monde. Si je n’arrivais pas à me lever, à faire des choses, peu importait : je savais que je finirai par le faire. La paralysie n’était pas une souffrance : j’aime l’immobilité, le temps seul avec soi-même, l’instant suspendu de l’inaction. J’aimais la voiture, la route qui s’étire à l’infini, être seul, avec soi-même. Nulle interruption, nulle obligation. Un jour, un instant, je devrai me lever, continuer : la voiture arrivera, l’adrénaline, l’instant me pousseront. Alors, je me lèverai. Je suis dans mon lit, je ne veux pas me lever. Je savoure ma « paresse ». Lorsqu’il faudra se lever, je le ferai. Lorsque ce sera nécessaire. Lorsque cela devient nécessaire, j’ai des stratégies : j’attends d’avoir envie de faire pipi, mon corps me forcera. Je réfléchis à la texture de l’ordre que je donne à mon corps : pourquoi, si je dis explicitement, dans ma tête, « lève-toi et marche », ne se passe-t-il rien, mais lorsque je suis intimement décidée à bouger, mon corps bouge sans que je ne lui dise rien (je ne pense pas en phrases) ?
Je ne suis pas paralysée : j’attends juste la volonté. Souvent, je compte jusqu’à douze. Allez, je compte jusqu’à douze, et je me lève. Si je rate la première fois, je recompte. Parfois, je choisis un nombre plus grand. Mais pas trop : si c’est trop grand, je perdrai le fil. Compter pendant une minute entière, quel ennui ! Je ne vis pas mal ma paralysie : je crois que c’est une question de volonté. Que je ne veux pas assez me lever. Ce n’est pas un problème. C’est acceptable. Je n’ai pas tant de choses à faire. Je suis une enfant.

Photo de Rido Alwarno sur Pexels.com
L’obligation me fera me lever. Peu à peu, je développe un ressentiment fort pour la contrainte, imposée par d’autres, ou par moi. L’école est une contrainte. Même, des fois, les sorties en famille, les choses que j’ai moi-même planifiées. Il faut sortir du lit, du temps suspendu, de l’infini. Il faut retourner dans le monde réel, celui du social et de la productivité. J’en veux à l’école, au réel. Je mets si longtemps à me dire que la contrainte est auto-imposée. Vers 16, 17 ans, je réalise que je pourrais simplement arrêter de me lever, un matin. Je flotte dans mes fantasmes d’hôpital psychiatrique, de paresse institutionnalisée. Pourtant je me lève toujours, chaque matin. Parler de mon mal-être, de mon envie de ne rien faire, de dormir une année entière avant de même pouvoir ouvrir à nouveau la bouche, parler au monde. Non. C’est plus simple de continuer, de courber le dos, d’accepter. Si je me lève, si je vais à l’école, peut-être pourrai-je ne parler à personne. Laisser le temps couler sur mes plumes, me ramener encore ce soir, le lit, l’oisiveté, le droit de ne pas parler et de ne pas exister. Si je me lève, en plus, il y a une chance que je finisse par vouloir parler, que j’aille mieux, que j’aime des instants. Que je change.
Je n’en veux pas à ma paralysie ou à ma paresse, j’en veux à la contrainte. Peu à peu, c’est comme si j’étais deux : un moi social, un moi quand je suis seule. Puis quatre : deux personnalités sociales, Claire et Carlie, l’une qui performe à l’école, l’autre qui performe socialement, deux personnalités de solitude, Ondine et Espérance. La désespérée, colérique comme l’océan, et la rêveuse, pleine de magie et d’espoir. Toutes deux sont poètes.
Je ne suis que ces dernières. Je n’existe que quand je pense, je ne pense que quand je suis seule. Peu à peu, j’oppose exister et être socialement : j’existe seule, je suis un robot en société.
Puis la vie, les amis, le couple. Continuer à vivre entre le social et le solitaire, malgré tout. Le social m’apporte tant, malgré tout.
Puis j’ai 24 ans : je vais voir une psy. Je commence les diagnostics, les réflexions, l’écriture. Tout à déconstruire, à réconcilier. Et découvrir que, peut-être, dans cette quiétude à ne rien faire, il pourrait y avoir une paralysie, une angoisse, qui m’a fait détester le monde. Qui me fait parfois regretter le monde social, qui pourtant, seul, m’apporte du neuf, de l’intéressant, du changement.
Curieuse de savoir comment vous avez intellectualisé votre inertie ?
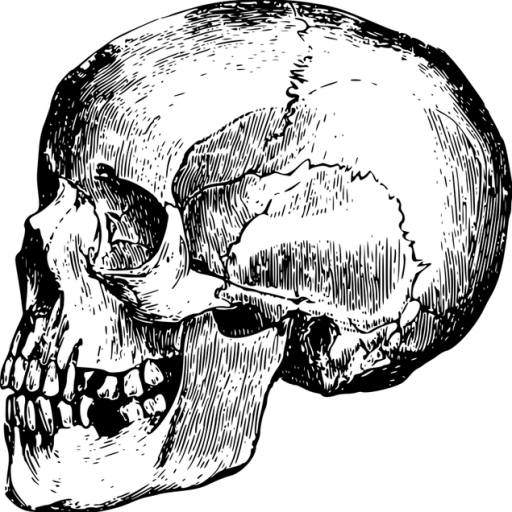




Laisser un commentaire