
Mon dernier livre, Splendeurs et misères de la Mort, parle de la Mort. La Mort comme personnage. Elle suit les morts des gens, recueille leurs derniers instants, leurs dernières pensées, celles qu’on aurait perdues sinon.
Donc, bien sûr, mes personnages meurent. Certains au chaud dans leur lit, d’autres de maladies ou d’accidents. Certains sont assassinés ou exécutés. C’est l’histoire. L’instant de la mort me perturbe et me fascine, m’a brisée, ado (voir Mon rapport à la mort).
J’en ai discuté, récemment, avec un proche. Il a eu du mal à lire le livre. Il m’a dit que j’étais dure avec mes personnages, qu’il aurait voulu les sauver. Qu’on voyait bien que j’étais autiste, avec cette « distance émotionnelle ».
Hmm. Outch !

Bien sûr, j’ai un rapport distant avec le monde réel, avec les autres. Un rapport intellectualisé. Le monde est vaste, incohérent, inconstant, terrifiant. Je le tiens à distance. J’essaie de le comprendre, parfois au détriment de le ressentir. Parfois pour le ressentir de façon moins angoissante.
J’ai un rapport distant à mon corps et à la corporalité en général : je m’intéresse moins aux sensations, aux visages, aux corps, et je me concentre sur les idées, les concepts, la beauté, la sensation intellectuelle et émotionnelle du lien. Les émotions, en fait. Les émotions, les pensées sont plus importantes que les corps. Et les histoires.
Oui, mes personnages meurent. C’est le concept de l’histoire. C’est ma façon de me confronter à la mort. C’est probablement une position de privilégiée, comme me l’avait dit quelqu’un d’autre : je n’ai pas côtoyé la mort de si près. Je l’idéalise en refusant sa composante physique et triviale. Mais j’ai fait l’expérience émotionnelle du vide, du vertige d’imaginer le monde sans sa propre conscience, et sans celle d’autres – on adore les pensées intrusives et mon besoin maladive de m’imaginer perdre des proches. Ce n’est pas amusant, je ne le fais pas par plaisir, mais ça se produit.
Oui, mes personnages meurent. Mais je suis là avec eux. Je récupère ce qu’ils perdraient sinon : leurs dernières pensées, leur histoire. C’est difficile de me connecter à eux, mais au moins ils ne sont pas seuls, pas éteints pour toujours. On n’a peut-être pas la même vision de l’empathie – je ne vis pas dans la réalité, moi ! -, mais c’est la mienne : sauver les esprits, accompagner face à une forme de fatalité absurde, c’est ma façon d’exorciser la mort. De l’accepter. De lui donner sens. Je ne peux pas juste l’ignorer.
Je comprends bien qu’il est déroutant de lire mes livres et de savoir comment je ressens le monde – j’ai eu, j’ai encore honte de ma « distance ». D’être froide, de ne pas aimer assez, de ne pas ressentir assez cette connexion formidable que les livres et les histoires décrivent et qui me paraissent être un rêve pour nous rassurer plus qu’une réalité concrète. J’ai eu honte et peur d’être sociopathe, de pouvoir tout rationaliser. D’être une mauvaise personne.
Mais voilà. C’est comme ça. Je ressens comme ça. Je ressens. Je ne souhaite le mal de personne.
J’essaie d’ailleurs de ne pas juger les personnes qui ont un diagnostic de sociopathie : ils ne sont pas intrinsèquement mauvais.
Mourir seul, c’est terrible.
Cette conversation m’a tourné dans la tête pendant des jours. Comme si ç’avait été un rejet, une réprobation, un jugement moral – qui appuie sur un complexe que j’ai clairement, et ancien. Parler de torture, se mettre dans la tête du tueur, c’est horrible : pour moi, c’est aussi de l’empathie. Essayer de le comprendre. Bien sûr, les tueurs me paraissent étranges : comme tout le monde. Personne ne fonctionne tout à fait comme moi. Tout le monde est étrange. J’essaie de comprendre tout le monde (j’étudie la psychologie, après tout…).
Ah, s’il n’aime pas les tueurs et les morts, il n’aimera pas mon prochain livre ! Et, soudain, j’ai réalisé que c’était déjà le sujet de mon prochain livre, que j’ai fini cet été, avant cette conversation : Arthur est écrivain, il écrit des polars, des tortures psychologiques, des horreurs, et en a profondément honte. Honte de pouvoir l’imaginer, honte d’être fasciné par l’extrême de la pensée et de l’action, de se sentir à distance, de ne pas être certain qu’il serait absolument incapable de tout cela.
Honte de sa posture rationnelle, de ses doutes, de ses réflexions sur des valeurs, qu’on lui a si souvent présentées comme immuables, instinctives. Mais même les philosophes l’admettent : les valeurs, le bien et le mal, c’est une vraie question, et pas un absolu inattaquable.
Curieuse d’avoir vos avis. C’est vraiment un sujet central et douloureux pour moi.
Voir aussi : avoir honte de soi et à quinze ans je pensais être sociopathe
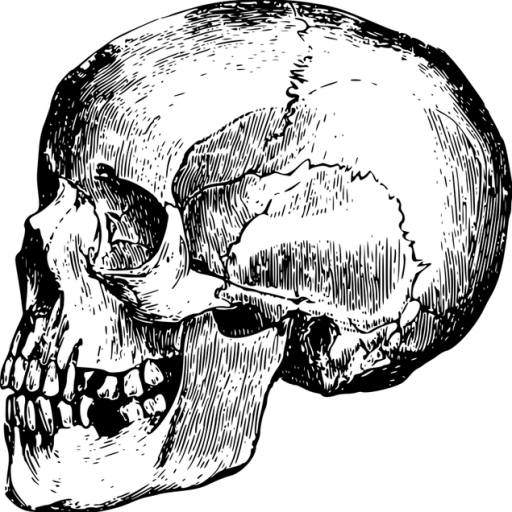




Laisser un commentaire