La semaine dernière j’ai décrit la théorie des shutdowns et des meltdowns autistiques. Depuis que je connais le concept, j’essaie d’appliquer un peu à ma vie.
Voir Meltdowns, shutdowns et Le fonctionnement par crises
12 avril 2014 – Devoir de sciences sociales
Je veux fuir le monde. Je ne sais pas ce que je fais là. Le sens que les autres y trouvent ne me touche pas. Devoir de sciences sociales. Dissertation de six heures. Nous sommes serrés dans un amphi de TP de physique. Je ne me souviens pas du sujet. La prof nous fait face, nous surveille, sur son ordinateur, lisant, attendant son train, elle rejoint son copain à Marseille après le devoir. Elle a dû nous le dire.
Le temps s’étire. Six heures, c’est long, mais il y a un objectif, un devoir, une corvée. Dans six heures je serai libre, même avant si je me dépêche, mais le devoir à rendre, les pages à gratter, l’intérêt à trouver se dresse entre cette liberté et moi, mur immense et qui me paraît inattaquable. Je le sais, pourtant, que je vais le faire. Comme chaque fois. Je vais dépasser ma désenvie, produire une dissertation médiocre qui sera jugée acceptable, obtenir une note passable, entre 8 et 12/20, c’est la prépa, c’est normal.
Le sujet ne me revient pas. Je n’aime pas trop la sociologie, à l’époque. Plein de stats – les mathématiques que j’aime le moins -, de généralisations abusives, d’histoires d’autres dans lesquelles je ne me retrouve pas, de clichés.
J’ai mes petites habitudes. Lire le sujet, surligner, écrire des choses sur mes brouillons, feuilles colorées. Tout ce que le sujet m’évoque, surtout pas de réflexion. Recracher le cours, essayer de savoir ce que le prof veut lire, prétendre dénicher une problématique alors que je ne fais que poser la question qui me permet de recracher toutes mes références laborieusement revues la veille au soir.
Le temps, l’obligation s’imposent. Le poids du devoir, de l’obligation, face à la montagne infinie que j’appelle à l’époque tristesse, sentiment d’absurdité, que j’aurais pu appeler à d’autres moments flemme, désenvie, désintérêt.
Le question du pourquoi même s’efface. Il ne reste que le manque d’envie.
Après la rédaction de l’introduction, je vais aux toilettes. Que j’en ai envie ou pas, pour fuir, pour m’accorder cinq minutes de pause.
J’y pleure. Je ne veux pas y retourner. La sensation de ne pas pouvoir, de ne pas avoir la capacité mentale et physique de le faire, me submergent.
Le masque est fort. Après plusieurs minutes, j’y retourne.

20 décembre 2014 – Le cours de conduite
Quelques mois plus tard. Samedi 20 décembre 2014. Je suis dans un état presque catatonique depuis la veille, je survis – fermeture autistique. J’ai pleuré, hier soir, en revenant de la grande séance d’orientation qui précède les vacances d’hiver. Je ne sais pas où je vais aller, comment m’orienter, quoi faire. Rien ne m’intéresse, tout a le goût amer mais douceâtre de l’indifférence. Je veux que le monde s’arrête, ne plus subir aucune demande. Me perdre dans ma tête. Mon mantra interne, c’est laissez-moi tranquille. Fuck you, écrit encore et encore, une lettre sur l’autre, jusqu’à l’amas d’encre illisible.
Je suis rentrée à la maison. J’ai cours de conduite – une occurrence fréquente, les samedis où je peux rentrer, et que j’évite comme la peste. Je ne peux décrire exactement ce que je déteste tant dans ces cours, je me fustige, il serait si simple de les supporter, qu’ils passent, en être débarrassée. Mais ils m’emplissent d’horreur, de froideur, d’envies d’évitement.
J’y vais, pourtant. Nouveau moniteur, nouvelle voiture. Il se moque de moi car je ne comprends pas que la voiture n’a pas de clef, ne trouve pas immédiatement le bouton pour la démarrer. Il parle, m’indique, je ne dois pas bien conduire. Je tremble de plus en plus. Sa voix vient d’un brouillard. L’obligation seule me maintient encore. La force du masque et du devoir. Il me fait arrêter sur un chemin, au bord de la route. Chemin de terre, terrain vague, vague comme moi. Je fais ce que je peux, juste assez pour survivre jusqu’à la fin de la torture, de la surcharge, du trop. On s’arrête, il me parle. Tu crois que je ne te vois pas trembler. Il faut y passer, c’est comme. Moi, si je devais faire l’hélicobite sur le toit pour avoir mon permis, je le ferais. Mes premières larmes coulent. Je voudrais que le moment disparaisse. Je ne peux pas me permettre de craquer complètement. Le masque craquelle mais tient encore. Je ne sais comment, la leçon continue. Les larmes aux yeux, j’atteins le bout des deux heures, je rentre chez moi, défaite.
On me demande comment c’était, de raconter. C’est trop. Trop de sociabilité, de normalité, trop prétendre car de quoi puis-je me plaindre, qu’est-ce qui s’est mal passé ? Rien. Je n’ai aucune légitimité à me plaindre. Mais je ne peux pas. Je craque. Mes monosyllabes ne suffisent pas, ce jour-là, on m’indique que ce serait bien que je fasse un effort et que je ne fasse pas la gueule tout le temps. Alors je me brise, et je fais ce que je voulais faire depuis le matin.
Je disparais.
Je m’enfuis.
Je m’enferme dans la salle de bain, et j’essaie si fort de me convaincre que le monde n’existe pas.
Je finis au service médical de garde pour « détresse psychologique ». Le médecin me fait la morale, je n’ai aucune raison d’être malheureuse.
Si vous saviez comme je le sais, ça.
La pression de la prépa était un terrain propice aux crises. Il y en eut d’autres, de ces « crises de réalité », de ces moments où le monde était trop à gérer. Il s’agissait surtout de surcharge émotionnelle – si la surcharge sensorielle était présente, je ne m’en rendais pas compte, tellement enfoncée dans ma tête et ressassant une tristesse et une recherche vaine de sens.
Mais c’était la prépa. C’était normal de craquer. Même aujourd’hui, j’ai du mal à me dire que c’était, sans l’ombre d’un doute, des crises autistiques. Pourtant, ce sentiment, dans la crise, que le monde est loin et en même temps trop présent, pressant, inéluctable. Pourtant, le souvenir de la brûlure des larmes, le froid du sol sur lequel je suis assise, ce camarade qui me prend dans ses bras, ce que je n’aurais normalement jamais autorisé. Pourtant, la difficulté à expliquer les crises, à avoir une raison. Ce n’était pas le stress – tout cela avait si peu d’enjeu, parfois. Je n’avais pas d’autre objectif que survivre et gagner ma tranquillité.
Il y en eu d’autres. Dont je me souviens, ou pas. Que j’ai racontées, ou pas. Expliquées, rarement. Que dire ? Si encore j’avais eu conscience que la musique était trop forte, les sensations trop présentes !
Mais c’est arrivé, aussi.
Samedi 30 juin 2018
Mariage de ma cousine. Transition, encore – début des vacances, encore. Je viens de finir mon stage. Il y a de la musique, je « ne suis pas d’humeur ». Mauvais jour. Il y a des jours comme ça. Ça arrive.
La musique fait vibrer ma poitrine. J’ai du mal à dire que je déteste la sensation, mais je ne peux penser qu’à ça. Je n’aime pas ça.
Deux heures du matin. Je ne vais pas bien. On me parle, on exige quelque chose de moi, le monde est trop réel !
Je pleure. Je me brise. Encore.
Demain, il faudra revenir, s’excuser, expliquer l’inexplicable, ou bien vivre avec le non-dit.
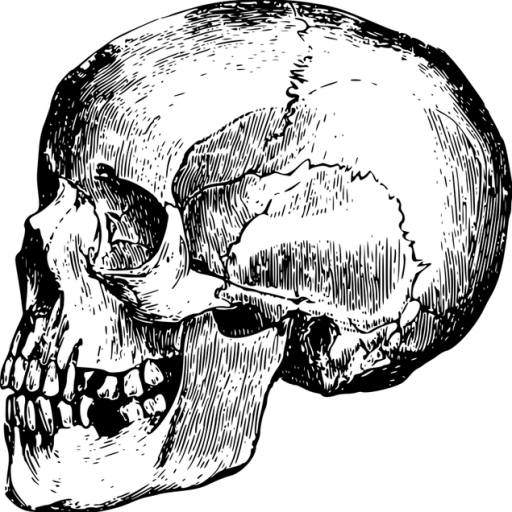




Répondre à Marie Neyron Annuler la réponse.