
Aujourd’hui je suis censée travailler. Je suis au bureau, face à mon ordinateur. Mon esprit vogue. Des choses arrivent, je les traite, rapidement, pour m’en débarrasser le plus vite possible. Au mieux, certes, mais au mieux des capacités que je me ressens à ce moment-là, et pas au mieux d’un idéal inatteignable.
J’ai lâché prise. Travailler me semble surréaliste. Huit heures par jour. Qu’est-ce que je fais là. Une tâche – je la fais. Instant de vide, d’inaction. Mon esprit vogue. Actualités. Memes. Téléphone. Ecrire. Faire semblant. Paraître occupée, comme une injonction fondamentale, comme une nécessité primale, et je ne sais même pas pourquoi. Parce que si j’annonce que je ne fais rien, j’aurai du travail en plus, et je n’ai pas envie d’en avoir plus. Parce que ma maigre réputation d’employée efficace et dévouée me protège pour les moment, comme maintenant, où je n’arrive à rien faire. Je regarde le vide en faisant semblant de lire. Je ne cherche même pas à me distraire – je n’arrive pas même à me concentrer sur un projet personnel, une recherche. J’ouvre Wikipedia, article au hasard, intéressant, mais pas intéressant, pas engageant, je ne veux pas d’une autre page. Actualités, le monde est triste, absurde, je ne veux pas d’une autre page. Travailler un peu, pour conjurer le sens, mon esprit est vide, je ne trouve rien à faire. Quelle initiative me resterait-il ?
La lumière de l’écran m’aveugle. Je flotte dans le bruit de l’open space. Comme hors de mon corps. L’image sur les écrans me semble de plus en plus lumineuse. Aveuglante. Je ne sais plus ce qu’ils affichent. Que faire ? Je me lève. Je vais aux toilettes, fuir le présent inexorable. Instant suspendu d’absurdité. Le monde se réduit à une cabine d’un mètre carré. La porcelaine froide. Les bruits étouffés. Oh. Quelqu’un rentre. Se sert de l’évier. Je devrais sortir, retourner à mon bureau. En passant je jette un œil aux écrans des autres. Je reconnais les logiciels. Ils travaillent, ou ils sont meilleurs que moi pour faire semblant. Ils travaillent, toute la journée, c’est tout juste s’ils interrompent leur productivité pour se servir de leur téléphone, pour aller au café, pour éventuellement parler une minute avec d’autres collègues.
Je regarde par la fenêtre. C’est l’été, il fait incroyablement beau et chaud, mais la clim est ronflante et les stores baissés. On se croirait en novembre, si on ne voyait pas le bleu du ciel en plissant les yeux, à travers le store trois-quarts occultant.
Je me lève. Je ne me souviens pas avoir voulu me lever.
Répondre à un message.
Je suis debout. Je sors du bâtiment, après les fumeurs le font cinq fois par jour. Je fais le tour du bâtiment en marchant. Je me sens stupide mais mieux en bas qu’en haut, à mon bureau. Parfois je m’assois, je ferme les yeux et je regarde le soleil, à travers mes paupières rougeoyantes.
Notification. Mon téléphone vibre. J’ai envoyé ma détresse à d’autres qui la partagent peut-être. Répondre vite, ne pas paraître être en permanence sur mon téléphone.
Prendre le temps de répondre. Je ne veux pas y retourner tout de suite.
Message instantané – professionnel. Le lire pour s’en débarrasser, espérer que l’effort n’est pas trop gros. S’il l’est, me mettre un point pour demain. Pour plus tard. Pour le moment où l’urgence fera disparaître le brouillard de la désenvie.
Culpabilité, car je connais ma chance. Parfois, ne voulant pas travailler, je lis des témoignages d’autres, qui comme moi trouvent que leur travail ne leur convient pas, mais ils sont pris à la gorge, ils doivent travailler toujours plus juste pour survivre, pour une vie médiocre par rapport à leurs rêves.
Je suis dans un microclimat économique. Ma situation dépasse les maigres rêves, les maigres attentes que j’avais. Ma situation me permet de rêver qu’un jour, je m’appartiendrai en plein, que je pourrai vivre sans me contraindre à cette absurdité.
Mais de quel droit ? Les autres travailleraient pour que je vive un peu sereine ? Pour que je sois libre d’écrire, de lire, de faire ce qu’il me plaît ? Ces autres, aiment-ils le travail ? Trouvent-ils que ce qu’ils font est utile ? Oui, de quel droit rêvé-je d’être heureuse ?
17h.
17h15.
17h30.
J’ai fait tout ce que j’avais à faire aujourd’hui. En en gardant un peu pour demain, qui n’était pas urgent. J’ai géré les nouveautés, assisté aux réunions. Passé plusieurs heures dans le brouillard. Je sors du bâtiment, je cligne des yeux, chausse rapidement mes lunettes de soleil.
À quel heure est-il raisonnable de partir ?
Si je n’ai plus rien à faire ?
Pourquoi me caché-je alors que mon travail est fait ? Pourquoi l’impression que je pourrais toujours en faire plus ?
Il paraît que je fais un « bullshit job« . Je vends mon âme et le diable est plus offrant.
C’est un boulot parfait.
Il y a 22 marches entre le rez et le premier, 17 entre les autres.
Etranges stores, qui donnent l’impression d’être en novembre.
Notification.
Où suis-je ? Que raconterai-je ce soir de ma journée au travail ?
Suis-je payée pour mon travail ou pour mon sentiment de culpabilité ?
On dit que je suis une bonne employée, pourtant.
Comme le monde est absurde.
Au moins j’ai écrit un article. Était-ce une pause ou mon temps de travail ?
Tout est flou. Et j’ai fait mon travail.
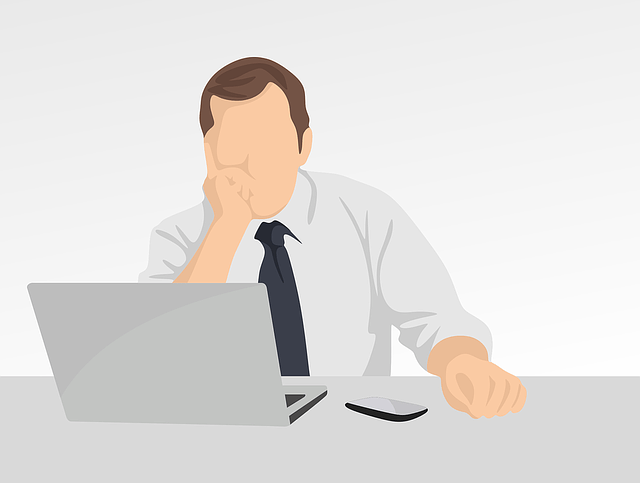
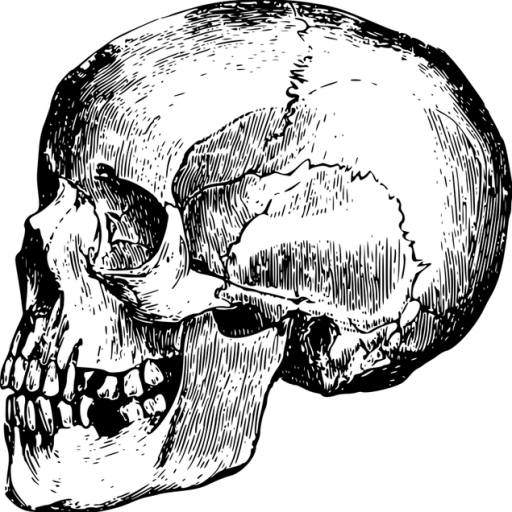




Répondre à La dépression et moi : partie 3 (le travail) – Haut Potentiel d'Aventure Annuler la réponse.