Ou : le complexe de l’hyperinflation allemande

Souvent, le monde ne me paraît pas tout à fait réel. Parfois, il l’est trop.
La « pleine présence » au monde est un concept étrange pour moi. Avoir l’impression de vraiment vivre. Moi, j’ai toujours l’impression d’être en attente de commencer à vivre – je ne crois pas être la seule.
J’ai passé très longtemps dans une sorte de plat, de vide des émotions, à tout combattre, sans combativité aucune. Je vois mon adolescence, et les années qui ont suivi, comme une immense fatigue, où je sauvais les meubles, je faisais les bonnes choses, sans avoir l’impression de vivre. Le plus souvent. Il s’est passé des choses agréables, aussi.
Il m’est difficile de me défaire de ce mode de fonctionnement. Ignorer au maximum les émotions négatives, le stress, les échéances qui s’approchent, l’angoisse quotidienne de vivre dans un monde que je ne comprends pas bien et de supporter des contraintes dont je ne vois pas le sens.
La prépa en est un bon exemple.
Je n’apprécie guère ce que j’apprends, ou je ne suis pas en état pour l’apprécier. Mon esprit est indisponible, la ligne est absente ou occupée.
J’ai beaucoup de contraintes. Les heures de cours, passent encore, je peux être passive, je n’ai rien d’autre à faire que d’exister, avachie sur ma chaise, et les conséquences de mon inattention peuvent être repoussées. Pour les devoirs écrits, c’est plus compliqué. Il faut être présente, il faut cracher ce que je connais d’un sujet, il faut bourrer tout ça dans un plan en trois parties, écrire une introduction, aller aux toilettes respirer et prendre du courage pour la suite, puis écrire mes six, neuf, vingt-sept parties parfois. Faire des transitions, faire croire que je réfléchis, ajouter des conjonctions de coordination pour plâtrer un peu le vide abyssal de ce que j’écris. Tristement, ça marche à peu près. C’est correct, pas glorieux, et je passe deux ans à attendre ce fameux « déclic » grâce auquel l’exercice me paraîtra moins abscons.
Il n’arrive pas.
Ce qui arrive, avec régularité, c’est les khôlles. Ces interrogations orales, seule avec un prof. Deux fois par semaine. Je les appréhende avec un grand inconfort. Et, certains jours, c’est la crise. La réalité est trop forte. Je la nie jusqu’au dernier moment. La prof me tend le sujet, à préparer une heure – j’ai le choix entre, je crois, Pierre Mendès-France et un autre sujet dont je ne me souviens pas, du genre La papauté en Europe. Je pleure. Je les vois à peine. Je ne veux pas. Je ne peux pas. Je ne veux pas !
Je voudrais que le monde se dissolve autour de moi.
Je dois aller chercher le sujet dans le casier du prof. J’ai passé la journée hors de moi, comme absente, angoissée pourtant. Le dossier tombe. L’hyperinflation allemande. Encore. Il y a quelques mois, j’ai déjà échappé à cette khôlle en me mettant à pleurer. Je pleurerai encore.
Les profs sont dépités, ont pitié, en ont marre.
Je veux rentrer.
La prof d’anglais me prend dans ses bras. La vice-principale appelle mes parents.
Je fuis, la vision brouillée par les larmes.
Je rentre chez moi. J’ai échappé à la pression absurde de la réalité, pour l’instant. Demain est un autre jour, il sera sûrement pire, je vais devoir revoir le prof en question, il me posera peut-être des questions – quoique la propension des gens à exprimer de la pitié dans ces situations, et ensuite à ne plus jamais en reparler est forte. On croit que ça change quelque chose – c’est faux.
Samedi, je suis rentrée chez mes parents, pour une fois. Ils me laissent seule le soir, il y a The Voice à la télé. Il y a un problème de communication entre une candidate et un juré (vraiment inconséquente, un quiproquo comme il y en a vingt fois par jour : Garou comprend que la candidate Loïs, plutôt androgyne, s’appelle Loïc, lui parle comme à un garçon). Je pleure. Je suis horriblement mal à l’aise, en surchauffe, seule chez moi. J’éteins la télé. Je me tape littéralement la tête contre le mur (enfin, le placard des assiettes). Je ne comprends pas ce qui m’arrive.
Le monde est juste… trop.
Dormir, pour se remettre à zéro. Repartir, un peu moins mal.
Mon ordinateur ne fonctionne pas. Je sais que je clique sur le bon bouton, mais tout échoue. Il freeze, il fait des choses étranges. Je me mets dans une colère noire.
Un peu plus tard. Je suis en école d’ingénieurs, j’apprends à coder. Bien sûr, parfois, on exécute le code, et ça ne fonctionne pas. Une camarade me parle en même temps, tout m’énerve, je l’envoie bouler méchamment.
J’ai grandi, je joue au badminton, mais soudain ce n’est plus un jeu, c’est moi à six ans et à quatorze, je suis nulle, je rate tout, je ne sers à rien, mon corps ne m’obéit pas, le monde m’est étranger, je suis épuisée, et je m’énerve (et le badminton, c’est NUL). Contre moi-même, puis contre les autres, qui me parlent. Qui jouent trop bien. Qui me mettent en danger. Je ne suis en colère que contre moi, j’ai l’impression que tous mes progrès ont disparu. J’ai quatorze ans et je ne veux plus jamais avoir quatorze ans. J’ai honte.
J’ai six ans et je fais des colères. Je ne comprends pas les autres, je n’ai pas confiance en moi, je suis la plus jeune et parfois le dindon de la farce – ou je le ressens comme ça. Si on rit, cela doit être de moi. Je ne sais plus. Je m’énerve. Les émotions sont plus grandes que moi, je dois partir. Je me réfugie dans ma chambre, en faisant du bruit dans les escaliers. Je me sens déjà stupide. Je sais que je vais devoir redescendre, trouver à manger, peut-être – c’est souvent pendant le repas. Affronter les regards, les remarques amusées, les « ça va mieux ? ». J’ai honte aussi.
J’ai sept, huit ans, je pleure dans le couloir de la maison peint en rose framboise. L’est-il déjà ? On me demande ce qui ne va pas, je réponds juste que j’en ai marre. De quoi ? De tout.
J’en ai marre. Je suis fatiguée. Je n’ai pas l’énergie émotionnelle de gérer le présent.
Je veux que tout disparaisse.
Laissez-moi tranquille, laissez-moi dormir.
J’ai vingt-cinq ans. Je dois prendre la main dans une réunion avec toute mon équipe. Je ne suis pas assez préparée, mais cela suffit à chaque fois. Je n’ai pas envie. Les autres parlent, j’étais heureuse de les voir – cela arrive rarement depuis le covid -, mais je n’arrive pas à me mêler à la conversation, à rejoindre la réalité.
Je pleure dans les toilettes.
Dans mille cabines de toilettes, au long de ma vie, endroits de paix et de détresse.
Quinze minutes avant la réunion, je craque. Je pleure. Depuis combien de temps cela ne m’était pas arrivé en public ?
On me raccompagne chez moi. Je pleure longtemps, je finis par faire fuir le chat.
Le lendemain, tout est normal à nouveau. Cet étrange normal qui me paraît toujours un peu surréaliste.
Entre deux vides, la crise. Longtemps ma seule façon d’exister.
Je deviens larmes, je deviens colère, je deviens désespoir, je deviens angoisse.
Je deviens surexcitation, parfois, je parle vite, je dis tout ce qui me passe par la tête.
Je deviens douleur – je me fais mal avec mes ongles. Bien plus facile à gérer que le trop du réel qu’il faut affronter. La douleur, au moins, m’appartient, et je la maîtrise.
J’ai longtemps fonctionné par crise. Encore un peu.
Je suis peut-être moins forcée, contrainte, aujourd’hui. Je peux échapper au réel. Le travail reste un lieu de contrainte, et de souffrances associées.
Je fonctionne.
Parfois, je me sens vivante, je me sens heureuse. Cela au moins a changé.
Aujourd’hui, je me renseigne, j’entends parler de meltdown autistique. La suite au prochain épisode, je ne veux rien affirmer sans avis de professionnel. Si certains qui s’y connaissent me lisent, je serais extrêmement curieuse d’avoir leur avis ou leurs témoignages.
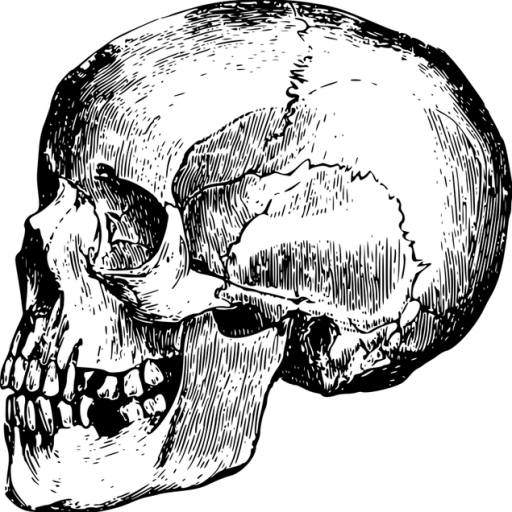




Répondre à Mes shutdowns et meltdowns – Haut Potentiel d'Aventure Annuler la réponse.