La moi publique et la moi privée sont presque deux personnes différentes. Ado, j’avais même théorisé ça en quatre personnalités, à qui j’avais donné des noms. Il y avait deux personnalités sociales, performatives, Carlie et Claire, la sociable, enthousiaste, et la scolaire, capable de faire ses preuves lors d’un oral de bac ou d’une dissertation de six heures. Et puis les personnalités intérieures, inaccessibles à quiconque, sauf peut-être au travers de l’écriture : Ondine, l’enragée, émo, poétesse sombre et dépressive, et Ondine, éthérée, idéaliste, qui s’émerveille d’une fleur ou du bruit du vent, qui s’émerveille du sublime d’un chat qui dort, qui languit dans la douceur d’une fin d’après-midi d’été, quand on vient de s’éveiller d’une profonde sieste.
Mes amis, ma famille, mon conjoint connaissent mieux mes personnalités intérieures, pourtant ils ne les ont jamais vraiment rencontrées. C’est probablement Ondine qui fait des crises, qui crie dans son oreiller, pleure ou se fait du mal, comme elle le peut, sans trop impacter la vie de Carlie ni de Claire : se cacher, toujours, comme si l’intériorité, cette appréhension de la folie, ce sentiment de perte de contrôle, était impossible à montrer. Comme si le cacher était un impératif moral. D’où vient cette vieille croyance, qui m’a accompagnée tout au long de la vie : il faut toujours montrer qu’on va bien, faire du mieux qu’on peut en dépit de la tristesse, de la fatigue, de la colère à devoir accomplir l’absurde, à devoir se sortir de son monde intérieur.
Je lis souvent que les autistes n’aiment pas être perçus, et j’en ai des exemples personnels : je « joue » aux jeux vidéo en regardant mon compagnon jouer, prenant les décisions avec lui. En revanche, je déteste absolument qu’on regarde par-dessus mon épaule, sur mes écrans. Je déteste qu’on assiste à mes process, je m’y sens inepte, incompétente. Je préfère mille fois présenter mon produit fini. Je ne sais pas gérer le regard des autres : croiser les yeux de quelqu’un, dans le tram, par exemple, m’emplit d’une forme de malaise, voire de culpabilité, de sentiment que quelque chose ne va pas. Sauf avec les petits enfants.
C’est grâce à cette distance entre l’intérieur et le public qu’on peut entendre : « mais, tu n’as pas l’air autiste » (personnellement, on ne me l’a presque jamais dit, mais je me le dis, j’ai du mal à accepter pleinement cette nouvelle identité, à savoir ce qu’elle signifie pour moi). Certes, car personne ne me voit craquer, ne me voit me taper la tête contre le placard des assiettes, pour une raison absurde, émotionnelle, ou pleurer dans les toilettes du boulot. Certes, Carlie est presque normale. Certes, elle est si proche de la normale que je me dis que je ne suis pas si handicapée, je suis juste nulle, feignante, empotée. Comment savoir si tout le monde n’a pas ça, ce masque, cette douleur interne ? Les autres travaillent bien, interagissent bien, et qui suis-je pour dire que c’est plus douloureux pour moi, qu’ils ne pleurent pas dans les toilettes, qu’ils ne sont pas pleins de désespoir ou de rage de devoir disparaître, de n’être plus eux-mêmes, pour travailler, quarante heures par semaine ? Les neurodivergents peuvent être très cruels avec eux-mêmes, voire avec les autres : c’est le classique « mais non, tu es tout à fait normal, je fais ça aussi, moi aussi j’ai supporté ça, moi aussi j’étais timide, je me suis forcé », etc.
Et, en fin de compte, c’est comme une force inconsciente, qui me fait devenir quelqu’un d’autre, qui me fait retenir mes larmes devant un film, pleurer bas pour ne pas être détectée dans les toilettes, qui « régule » mes émotions ou, du moins, leur expression sociale. Qui me pousse parfois vers la solitude, puis vers le monde : parfois bénéfique, plus facile, plus gérable. Mais moins moi. Ou une autre moi.
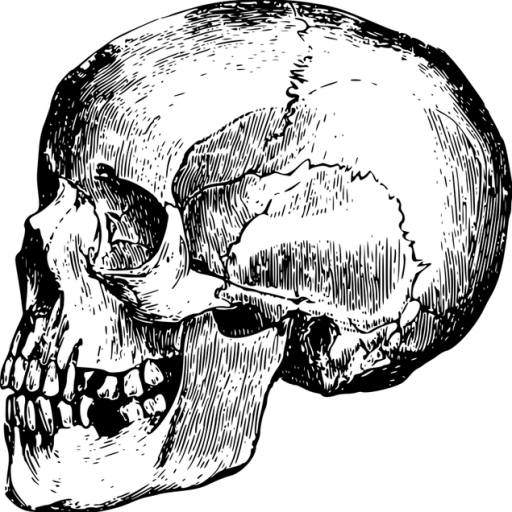




Laisser un commentaire