J’ai retrouvé récemment cet extrait de roman commencé à 14 ans. Je ne l’avais pas revu depuis des années, même si l’histoire reste présente à mon esprit. Quand je pense que j’ai encore souvent un sentiment d’imposture, que je ne suis pas vraiment autiste, que je m’approprie la souffrance et les difficultés des autres…
C’est un roman, bien sûr, une scène inventée, une mère inventée (je me dispute très peu avec ma mère, en réalité, et m’entends avec elle bien mieux que cette héroïne).
Mais tout est là. Un shutdown, un besoin de silence, un rejet des contraintes sociales. Les problèmes de santé mentale. Le bruit omniprésent. La tête qui tourne en permanence. L’ambivalence de l’étiquette « intelligente ». Le rêve d’un espace safe, un endroit calme et utérin, sans bruits ni objets à regarder. La sensation de disparaître, derrière un masque, dans le monde social.
C’est très grandiloquent, comme style. Cringe, aussi. Désolée, j’avais 14 ans, et je ne l’ai pas retouché.
La première fois que j’aurais voulu pouvoir me taire, et ne plus rien entendre, je devais avoir sept ou huit ans. Ma mère m’avait conduite dans un magasin. D’habitude, j’aimais bien faire les courses, mais ce jour-là je commençais à me dégoûter de toutes ces petites choses qui nous égayent d’habitude. Elle voulait m’acheter une jupe, j’aurais préféré un pantalon. C’est parti d’une dispute stupide, elle s’est mise à hurler dans le magasin. Je me sentais si mal, j’aurais voulu disparaître, qu’on m’oublie à jamais. J’aurais voulu n’être jamais née, pas parce ma mère me faisait honte, à ce moment-là, mais parce que, pour la première, le monde m’apparaissait comme trop dur, trop douloureux. Parce que j’aurais voulu devenir sourde, muette, j’aurais voulu que ma mère s’y soit habituée suffisamment pour ne plus jamais me parler. Parce que j’avais vu le monde comme je n’ai cessé de le voir depuis : sombre, cruel, infiniment détestable. Si tu savais, ma Julie, comme j’ai souffert depuis ce jour-là. Souffert de me savoir si insignifiante, et de voir que mes connaissances faisaient fi de cette insignifiance en m’accordant le détestable honneur de me donner de l’importance. J’ai souffert de voir ma mère au désespoir, si souvent. Et seulement à cause de moi. Alors je me suis dit, un jour, que si j’arrivais à devenir aussi diaphane et transparente que je croyais l’être, et aux yeux de tout le monde, alors ma peine comme la leur s’en trouverait allégée. La leur parce que cela serait comme si je n’avais jamais existé, à peine plus consistante que le fantôme des légendes familiales, à peine plus importante qu’un squelette dans un placard qu’on s’est efforcé de fermer à clef et d’oublier.
Toute l’année de mes huit ans, comme au début de l’année suivante, j’ai été envahie par une vague sensation de malaise, diffuse, sourde. Ecœurante à vomir, à pleurer, ce qui me semblait des litres et des litres chaque soir. Mais ce n’était alors pas comme aujourd’hui, où la seule idée de ma personne me semble destinée à me donner la nausée. C’était un lent et progressif dégoût de ce qu’était ma vie, au moment où je grandissais, sans en concevoir d’inquiétudes précises mais plutôt ce diffus malaise. Dans le même temps, je me suis renfermée sur moi-même, sans m’en rendre compte d’abord. Je rêvais d’évasion, de fuites lointaines, où solitaire j’aurais pu oublier mon monde comme ma vie décevante. Peu à peu, je me suis détachée du cadre que l’école imposait encore à ma vie. Je me laissais porter, insoucieuse de ce que le monde me faisait comme de ce que je lui faisais en retour. Cette année-là, celle du CE2, j’ai largement décroché sur le plan scolaire, n’écoutant plus en cours. Je ne réussissais à sauver la face –et les résultats- qu’avec ce que j’appellerais « mon intelligence maudite ». J’ai longtemps cru qu’une telle appellation se faisait le reflet de mon esprit prétentieux, étriqué et égoïste, avant de me mettre à considérer qu’une telle intelligence avait sonné la perte de nombreux autres, « poètes maudits », aux vies absurdes et toujours en quête d’une vérité transcendante qui n’arriverait jamais. Ce que j’en ai souffert également… Se sentir différente est une chose, mais autant l’être pour les bonnes raisons. Etre sourde-muette en est une. Se sentir plus intelligente que ce que la plupart des gens ne seront jamais est plutôt destructeur, pour la vie sociale comme pour l’esprit hurlant silencieusement sa douleur. L’idée d’être sourde-muette ne m’est pas venue transcendante comme un coup de foudre qui m’aurait frappée. Et laissée carbonisée sur le bas-côté de ce que d’aucuns appellent « la route de la vie ». Ce fut progressif, douloureux. Avant cet accident, je ne parlais déjà quasiment plus.
«Cet accident… Est-ce que tu… ? »
Est-ce que j’ai voulu me tuer ? Est-ce que je me suis volontairement jetée sous les roues de cette voiture ? Non. A l’époque, l’idée de la mort, volontaire qui plus est, n’avait pas frayé son douloureux chemin dans mon esprit. Est-ce que mon inconscient, lui, savait déjà ce que je risquais d’endurer, et a voulu m’en épargner ? Je n’ai pas de réponse. Plus probablement, j’étais distraite, ou plutôt pensive, comme toujours cette année-là, et je n’ai pas entendu cette voiture arriver. Toujours est-il que je me suis réveillée à peine deux jours plus tard, à l’hôpital, avec les deux jambes dans le plâtre, et suffisamment sonnée pour être incapable, pendant les premières heures, ne serait-ce que d’ouvrir les yeux. Mais j’entendais. Oh oui, j’entendais, comme je n’ai cessé d’entendre depuis. De manière distante, ne me sentant pas vraiment concernée, mais incapable d’occulter les paroles de mes proches qui se pressaient à mon chevet. Et quelles paroles ! Tellement inquiets pour moi. Ma mère pleurait sans discontinuer, mon père lui murmurait parfois des paroles apaisantes. A chaque nouveau visiteur, à chaque coup de téléphone, il expliquait un accident auquel il n’avait pas seulement assisté, et que j’aurais moi-même, pourtant sa principale protagoniste, été bien en peine de décrire.
Après qu’il fut assuré que j’allais vivre, sans aucune séquelle, pensaient-ils alors, les nouvelles d’avant mon accident commencèrent à s’échanger. Même au téléphone, j’imaginais sans peine les phrases de l’interlocuteur au bout du fil. C’était de vains échanges sur ce qu’ils appelaient ma réussite scolaire et que moi je qualifiais de désastre d’ennui et de vanité, de ce que je deviendrais, les « oh, ben oui, bientôt le collège… Non, on ne se fait pas de souci pour elle, tu penses… » m’écœuraient alors même que je ne pouvais pas ouvrir les yeux, et désespérait de plus en plus d’avoir à le faire un jour. Ces quelques jours, je te l’avoue, la volonté de me laisser couler m’a tenaillée. La vie telle que je la pressentais dans les paroles de mes parents ne me paraissait pas devoir être vécue, si dérisoire et pleines de faux-semblants que j’en étais presque décidée à ne plus jamais ouvrir les yeux. J’ai si peu dormi, ces deux jours-là, fascinée comme je l’étais par le dégoût naissant que m’inspiraient les paroles des deux personnes que j’avais jusqu’alors appelé Maman et Papa. Peut-être est-ce cette insomnie qui m’a réduite à envisager le suicide, ou plutôt l’abandon, une sorte de repos que je ne voyais pas comme la mort. Les dernières heures, j’étais de plus en plus lointaine, probablement éloignée par le manque de sommeil. Le vague souvenir que je conserve de ces heures est celui d’un relâchement absolu, d’une joie facile qui me submergeait sans pour une fois que je me sente obligée de m’éveiller de ce demi-sommeil. Je me sentais comme un bébé prêt à renaître dans un monde nouveau, flottant dans ma poche amniotique comme dans la douce chaleur d’un mois de mai, envahie par l’odeur de l’herbe humide, de la pluie tiède et de la tendresse que je m’imaginais me prodiguer la nouvelle mère qui me tenait au chaud en son sein, sans qu’elle ne me déçoive jamais comme l’avait fait celle que j’avais alors. Je croyais pouvoir rester l’éternité dans cette bulle de quiétude, et je n’envisageais rien de meilleur que cette existence paisible, où ma mère berçant son ventre m’insufflait un doux mouvement aux sensations de bonheur absolu. Peut-être m’enfonçant dans ce délice aurais-je renversé le pronostic que les médecins avaient posé pour moi. Peut-être serais-je morte dans mon Paradis déjà, et alors qu’aurait importé l’existence d’une vie après la mort ? J’aurais vécu mon Paradis comme personne n’en aurait vécu jusqu’alors, et mourir n’aurait pas été un tel inconvénient. Peut-être aurais-je fini par m’endormir, et me serais-je réveillée un peu plus tard avec le seul et vague souvenir d’un rêve brisé de Paradis perdu. Mais, un médecin que je hais et adore à la fois m’a réveillé soudain, à coup d’injections de je ne sais quelle substance, et de lumière hurlante déchirant mes yeux blessés qui flottaient alors dans la lumière tamisée d’un utérus imaginaire, me condamnant à jamais au souvenir de l’Eden interdit que je ne saurais retrouver, à la cruelle souffrance de la désillusion, et au navrant spectacle d’une triste chambre d’hôpital au blanc trop lumineux, où mes parents inquiet semblaient renaître alors que l’espoir vibrant d’une vie intra-utérine retrouvée m’était soudainement arraché. Imagine, Julie. J’avais touché l’éternité du doigt, et me suis retrouvée condamnée à l’anonymat de ma vie de gamine de neuf ans, mise face à une autre éternité, celle des tourments ineffables de mon adolescence qui se profilait devant moi. J’ai été déçue. Outrée, même. De quel droit me forçait-on à vivre, au nom du bonheur de ces parents que je ne considérais pas comme miens ? Et eux avaient l’air si heureux, et plus leur sourire s’élargissait en me voyant revenir à la vie, plus je me sentais prise d’une nausée irrépressible. Une telle colère m’a envahie, presque une fureur meurtrière, j’aurais voulu hurler, mais mon corps encore m’empêchait le moindre mouvement, la moindre parole. Aux sourires et aux pépiements de ma mère damnée retrouvée, je n’ai pu répondre. Ni insanités ni sourires et paroles factices. L’envie de ne plus jamais avoir à l’écouter à nouveau m’a reprise, si prégnante que j’ai cru ne plus pouvoir rester là. Quelque chose me semblait faux, irréel, je ne me sentais absolument pas à ma place. J’aurais voulu pouvoir m’enfuir, à défaut je me suis réjouie de ne pas pouvoir lui répondre. Je l’ai ignoré quelques heures, jusqu’à ce qu’un médecin très occupé daigne enfin venir m’examiner. De ces quelques heures d’attente, je garde le souvenir d’une période de latence, paix avant la reprise des hostilités.
Puis le médecin est venu, a assené un « temporaire » -à l’écrit, mais le coup n’en fut pas moins terrible- qui a ravi ma mère et anéanti ce qu’il me restait d’espoir. A ce moment-là, j’aurais préféré rester muette, avoir une excuse pour ne plus jamais adresser la parole à l’être qui me couvait des yeux. Je me suis abattue, désespérée, sur mes oreillers, feignant une fatigue qu’il m’était impossible de combattre, et sombrant dans un sommeil tout aussi factice que le sourire que j’avais forcé mes lèvres à afficher à l’annonce de cette désespérante sentence.
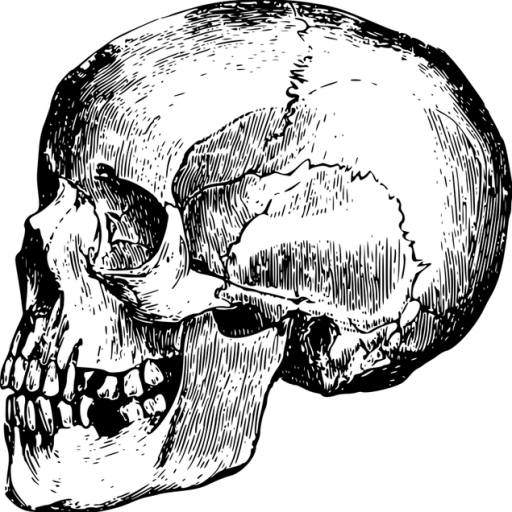




Laisser un commentaire