Voici, comme la semaine dernière, le début d’un autre roman, l’Expérience de la fragilité. Roman d’apprentissage, découverte de soi d’une neurodivergente qui s’ignore. Aventure intérieure.
Vos commentaires sont les bienvenus !
Voir l’article sur le livre
Quand cela avait-il commencé ? Croire à peine en l’existence des autres, et pourtant les laisser entrer dans sa vie ? En dépendre et ne pas les voir, les concevoir ? Elle ne se souvient pas. Elle a toujours été comme ça. Observer le monde, s’observer soi-même, créer des théories, ne pas pouvoir se cerner.
Des heures durant elle a observé et pensé le monde. Pensé au temps, qui s’enfuit et est là, donnée fondamentale de l’existence, le temps qui rend logique le fait que tous les endroits peuvent exister, et que pourtant elle n’en voit toujours qu’un.
Les rêveries, dans la voiture, des heures durant. Les maisons, au bord de l’autoroute, dans lesquelles vivent et ont vécu et vivront des multitudes de gens, semblables ou contraires, proches ou foncièrement différents.
La voiture file, à toute vitesse, le long de la voie, d’un seul regard il faut saisir un lieu, un lieu de vie, des vies. Un tracteur d’enfant en plastique, abandonné dans une cour poussiéreuse. Un portique soutenant plusieurs balançoires dépareillées, suivant l’âge des enfants. Une chaussure, sur le bord de la route, et elle imagine pendant des kilomètres comment elle a pu arriver là. Qui jette une chaussure sur le bord de la route ? Qui l’a perdue ? La fenêtre était-elle ouverte ? Qui ouvre une fenêtre sur l’autoroute, avec le bruit et le vent qui hurlent et fouettent ?
Elle pense aussi qu’elle ne connaît personne qui habite au bord de l’autoroute. Ces maisons, ces vies qu’elle aperçoit, sont forcément un peu différentes, un peu partielles, elle ne peut pas saisir la variété de toutes les vies en restant sur cette seule autoroute, elle manque la vie de ceux qui habitent à la campagne non reliée, dans les montagnes, loin des autoroutes. Elle ne peut pas imaginer la vie de ceux-là, ceux qui n’abandonnent pas leur tracteur dans la cour de terre battue, ceux qui ne sont pas bercés toujours par le bruit des voitures qui passent à cent-trente, ceux qui n’ont jamais trouvé au détour du chemin une chaussure, une valise, une sucette abandonnées, et ne se sont jamais demandé qu’elle était l’enchaînement, unique et toujours répété, de circonstances, qui l’avait amené là.
La voiture file, à toute vitesse, et les barreaux de la glissière de sécurité disparaissent, avalés par la vitesse, quand elle les regarde de front. Et pourtant, en regardant ceux qui apparaissent plus loin, par le pare-brise, par la fenêtre de la place de son père, elle les voit, distinctement, chacun l’un après l’autre, les petits barreaux de métal gris, les coulures de peinture, la mousse qui les colonise parfois. C’est un des mystères qu’elle contemple, qui l’occupe des heures durant, qui rend les trajets inépuisablement intéressants et jamais interminables. Et elle ne demande jamais qu’elle est la clef du mystère des barreaux de la glissière de sécurité.
Dans la voiture elle ne parle jamais, elle regarde dehors, des heures durant, et les heures passent sans qu’elle doive demander “c’est quand qu’on arrive ?”. Le plus souvent, elle ne veut pas arriver. Elle n’y pense pas, ou bien elle y pense avec regret. Surtout plus tard, quand le bus l’emmène au collège puis au lycée, quand les trente minutes de trajet sont une éternité contenue dans ses potentialités. Et si on avait un accident. Si un pneu éclatait. Si le conducteur faisait un malaise. Si une autre dimension s’ouvrait, si nous roulions à jamais, si la terre s’enfonçait, si un terroriste investissait le bus, si je sautais par la porte ouverte, si je refusais de descendre, si je restais là pour toujours, aller, retour, aller, retour, à jamais. Elle rêve que le bus continue, il ne va plus quelque part, vers une destination précise, il roule seulement, le monde est contenu dans l’habitacle, le temps est suspendu au-delà du pare-brise, rien n’est réel. Et soudainement le bus arrive, le temps éclate en existence, la réalité s’impose, les roues cessent de tourner. Les autres existent à nouveau, la bousculent, lui demandent c’est en quelle salle le premier cours, parlent, crient, se rendent tangibles et bruyants. Noir. Elle bouge, rideau. Premier cours, assise sur le côté de la classe, côté fenêtre, action, moteur, ça tourne, son esprit est de nouveau là, il n’est plus accaparé par la réalité du mouvement et la spontanéité du vivre. Elle peut de nouveau rêver, assise seule au milieu de la foule. Elle a quinze ans, elle a onze ans, elle a sept ans, elle rêve au milieu de la foule.
Elle est enfant, elle s’allonge dans l’herbe, pendant que son frère joue, elle ferme les yeux et elle observe la rougeur de ses paupières que le soleil traverse. Elle ferme les yeux et elle ne pense à rien, jusqu’à ce qu’elle sente une sorte de vertige la prendre, elle se sent bouger, et elle est persuadée que c’est le mouvement de la terre qui tourne sur elle-même qu’elle ressent. Elle essaie de séparer et d’analyser ses sensations, le souffle chaud du léger vent d’été, qui fait voler ses cheveux, les chatouilles et la surcharge sensorielle que ces cheveux provoquent, frôlant son visage, son cou, le duvet sur sa peau qui est si sensible et qui semble chargé d’électricité. Les sensations dans son corps, elle a chaud, elle a froid, parfois en même temps à des endroits différents, elle ressent une sorte de vertige, au creux de son ventre, quand la balançoire s’élève haut et puis retombe, lui laissant une seconde d’apesanteur. Elle ressent la pression sur sa vessie, et cette douleur agréable de se retenir. Elle s’observe, sentant des odeurs mille fois fréquentées, et elle se demande pourquoi elle les apprécie, pourquoi, instinctivement, elle les déteste. Pourquoi aime-t-on l’odeur du propre, des fleurs, des gâteaux qui cuisent et du chocolat fondu ? Pourquoi une odeur aussi agressive que la menthe poivrée est-elle vue comme agréable, mais celle des excréments sent-elle mauvais ? Qu’est-ce que cela veut dire, sentir mauvais ? Que se passe-t-il dans son cerveau, dans son corps, peut-elle transformer son cerveau et ses réflexes pour ne plus plisser le nez de dégoût quand elle a besoin d’utiliser les toilettes publiques ? Pourquoi trouve-t-elle, elle, que l’essence, la javel ou l’ammoniaque sont des odeurs plutôt agréables, entêtantes, qu’elle recherche ? Elle fait des expériences, parfois, elle mange des choses dont elle se rappelle un goût horrible, elle se dit qu’on ne peut pas se rappeler un goût, on garde seulement un jugement, mais toute nouvelle expérience est une expérience à part entière, et peut-être qu’aujourd’hui est le jour où le goût trop fort du choux de Bruxelles ne sera pas une agression à ses sens, une agression si forte que soudainement ses pensées n’existent plus, et elle fait une grimace, submergée par cet instinct qu’elle ne réussit pas à comprendre. Elle cherche à saisir cet instant, avec sa pensée, où sa pensée s’éteint, où la corporalité s’impose, où la réalité devient plus forte que le fil, dans sa tête, de sa subjectivité. Elle refuse l’idée que cette corporalité, c’est elle aussi, que son corps, c’est elle, que son sujet, ce n’est pas seulement cette suite de pensées et d’idées, que les sensations aussi font partie d’elle. Si elle les accepte, elle veut pouvoir les contrôler. Alors elle goûte des aliments qu’elle déteste, elle mange des choses qu’on ne devrait pas manger, que le monde a décidé de rejeter, du papier, du sable, de l’urine, même, elle veut analyser les goûts et les dégoûts, les réactions et les rejets.
Elle ne met jamais le doigt dessus, jamais complètement. Elle ne cerne pas ce moment. Lentement, elle se laisse gagner par les instincts et la réalité. Elle se perd, pour retrouver un corps que la réalité lui impose, sans jamais être vraiment ce corps.
Le corps a mille façons de se rappeler à sa réalité. De faire s’interrompre son fil de pensée. La douleur, aussi, elle croit pouvoir la contrôler. Elle est jeune encore, enfant, le champ est tellement libre, et elle a tant de temps pour y songer. On n’interrompt pas les pensées des enfants, tellement persuadé qu’il n’y a rien à interrompre.
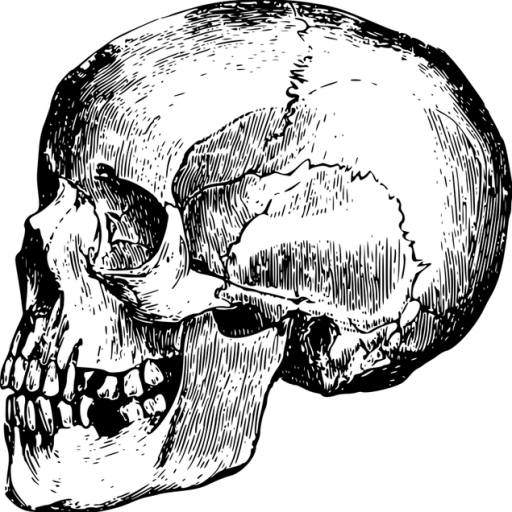




Laisser un commentaire