
J’ai lu Et Nietzsche a pleuré.
La philosophie de Nietzsche, deviens ce que tu es, se libérer de l’omniprésence sociale, des idées que les autres ont pour nous-mêmes, des idées qu’on se fait de ce qu’on doit être, ce que c’est que d’être une bonne personne.
Son médecin, le docteur Josef Breuer, qui se sent enfermé dans sa vie respectable, enviable, de médecin viennois et bourgeois, riche et établi. Qui reproche à sa femme sa propre incarcération, sa propre sensation de ne pas avoir vraiment vécu. Sa crise de la quarantaine.
Les débuts, les prémisses de la psychanalyse. Sigmund Freud en fond, jeune étudiant et confident de Breuer.
Et j’ai mal. Mal à ma liberté, à mon rêve d’échapper aux diktats sociaux, à mes rêves d’accepter mes limites, de faire quelque chose qui donnerait à ma vie tout son sens, qui m’offrirait l’enthousiasme qui ne me vient aujourd’hui que par bouffées sporadiques.
Et je comprends Nietzsche, moi qui ai lu le début de Zarathoustra, il y a si longtemps, et ai rejeté la pédanterie de croire qu’il existait quelqu’un au fond de moi, un être qui ne cherchait qu’à devenir. J’étais si bien caché dans mon masque, dans ma dissociation qui me protégeait des contraintes de la société que je croyais si lourdes, impossible à fuir.
J’étais pragmatique, j’en faisais même une fierté. Je savais quoi faire pour jouer le jeu, je le jouais avec la sensation permanente et profonde que ce n’était qu’un jeu, un théâtre, une absurdité. Qu’on n’est tous que des marionnettes, des pantins montés sur des ressorts, des manteaux qui cachent une infinité de mal-êtres qui s’accolent et tentent de noyer leur vanité dans l’alcool, les drogues ou la vie. Tous passifs, tirés par un destin hasardeux et cruel, une nature humaine et sociale sans pilote, sans yeux, sans espoir, sans émotions. Je comprenais les ivrognes presque mieux que les reproducteurs, que les messieurs-tout-le-monde qui vivent une vie normale, ont des enfants et meurent.
La vie est une prison. Le corps est une prison. La neuroatypie ne change rien, vraiment, à ce fait.
Mais la vie est vaste, et parfois, je rêve de liberté. Je l’avoue, parfois, j’en veux aux limites, aux cadres que j’ai moi-même choisis. Mon travail, comme un mauvais choix fondateur. Comme le symbole du pragmatisme, de l’obligation qu’il y a à se vendre, de la contrainte sociale. On ne s’appartient pas.
Parfois, même, les jours où je voudrais fuir, disparaître de moi-même, c’est tout le reste. La maison, et le crédit qui va avec. Le compte en banque et les investissements, bonimenteurs qui m’avaient promis la liberté. Le chat, qui dépend de moi. Les gens que j’aime, que je n’ai pas le courage d’abandonner.
Parfois, je me plais à croire que si j’étais seule, si je vivais en ermite au milieu d’une forêt, en autarcie, sans besoin de rien ni de personne, et que je serais heureuse et productive.
Je sais que c’est faux. Je sais que j’ai vécu seule et que je n’étais pas plus heureuse, loin de là. Que mes « productions » étaient des distractions qui ne donnaient pas sens à ma vie, pas assez, pas comme je voulais, pas de façon à oublier les contraintes qui existent par ailleurs.
La vie a une part de contrainte. La réalité est un carcan, et si j’ai tant opposé le monde réel et mon monde intérieur, qui me paraît plus réel, c’est que j’y suis plus libre – les contraintes ne sont que celles, immenses aussi, de mon esprit.
Se libérer, c’est trouver la part de contrainte et de vérité qu’on est prêt à accepter, qui fait sens pour nous. C’est Nietzsche qui le dit, plus ou moins.
J’ai voulu, un temps, me détacher entièrement du monde réel, des réalités sociales et matérielles (voir Un conte d’hyper-intellectualisation).
Je ne pense pas que Nietzsche était vraiment heureux, d’ailleurs il ne le souhaitait pas. Sa souffrance avait un sens pour lui, une grandeur immense, c’est suffisant. Pour certains, c’est la seule chose accessible. Aurait-il, à notre époque, été philosophe sur Instagram, aurait-il choisi un bonheur simple plutôt qu’une philosophie radicale ? Aurait-il été si radical, à notre époque, où le lien social est moins contraint mais moins fort, à l’époque des Hikikomori, qui vivent seuls dans des appartements japonais ?
Le monde de la pensée m’a fait rêver, m’a procuré quelques grands sentiments quand les émotions m’étaient largement inaccessibles. La pensée, l’érudition, la philosophie, les livres.
La question de les abandonner pour être heureuse a-t-elle un sens, font-ils partie de mon bonheur ?
La direction à prendre paraît toujours si simple, quand l’histoire, quand un narrateur omniscient a déjà pris les décisions, et en maîtrise les résultats.
Je rêve de liberté.
Les images qui m’émeuvent rêvent de liberté.

Cerf-volant, volant au vent, ne t’arrête pas…
Sur la terre, ou dans les airs, un enfant te voit…
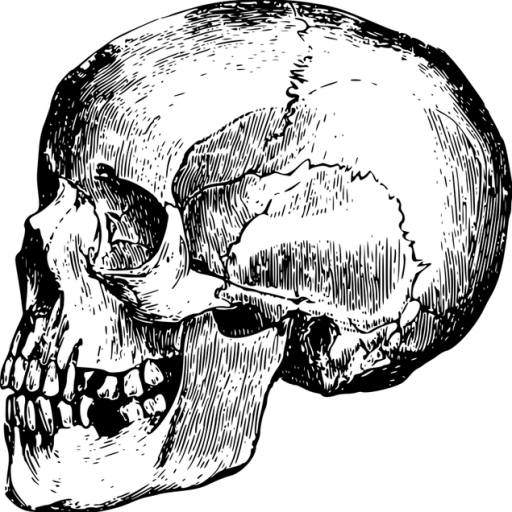




Laisser un commentaire