
Comme pour la première fois, je rêve d’avenir. Pas de ce qu’il faudrait que je devienne, pas comment me mettre à l’abri. Je réfléchis vraiment à une vie où, peut-être, chaque journée serait portée par l’enthousiasme. Où je me sentirais vivre.
C’est le matin, il fait beau. J’habite dans une maison, la vue est dégagée, sur la campagne, la montagne environnante. J’ai une véranda, un endroit où je me sens protégée, du froid, du dehors, de l’inconnu. Il y a un fauteuil suspendu à une poutre. Un grand espace de vie, du bois. Une ouverture et une lumière.
Je prends le petit-déjeuner. Si c’est l’hiver, du thé, du chocolat chaud. Peut-être un jus d’orange. Des tartines de pain aux graines.
J’ai le temps. C’est le point fondamental. Le temps. Pas de travail auquel aller précipitamment. De bouchons. De désenvie d’y aller. Ce n’est pas samedi, pourtant. Je ne vois plus cet impondérable, lundi, qui revient, qui m’empêche de profiter, qui me donne des velléités de productivité, de points à rayer de ma liste de choses à faire.
Je peux lire. Passer du temps avec mes proches, qui ne sont pas plus stressés que moi. Il n’y a pas le bruit de la télé, en fond, pour oublier que le temps à encore cours.
À seize ans, je rêvais avec mes deux meilleures amies de passer une journée entière sans regarder l’heure.
Et c’est ce que je fais. Le temps n’est plus cette denrée rare et traîtresse qui ramène la contrainte du lundi matin. Il n’apporte que des éléments que je prévois agréable.
Bien sûr, parfois, même les événements que j’ai prévus me sont contrainte. Mais je suis libre. J’ai trouvé mes limites, et la force de ne pas les dépasser.
Je travaille, j’ai un cabinet de psychologie. Un bureau décoré à l’ancienne, entre un cabinet de curiosité et un salon de lecture XIXème. Un arrière-bureau qui me sert d’atelier et de salle de lecture, coloré et enfantin. Eclectique. Chaque pièce son style.
J’aide les gens. Je ne suis pas étouffée à chaque instant par la peur de ne pas être à la hauteur, de leur faire plus de mal que de bien. Et je suis convaincue d’être utile, le plus souvent. Et ils m’intéressent. Je n’ai plus l’impression que, quoi que je fasse, mon boulot n’est qu’un achat de mon temps, inutile, sans conséquences. Je ne suis plus passive.
J’écris. J’ai vécu. On me raconte tant de parcours de vie, d’images de vie que je trouve belles. Les sublimes, les tragiques, les extatiques. Je les accueille. Je change. Je grandis. Je m’émeus. Je m’enthousiasme.
Je me pâme de la beauté des idées.
J’écris.
Cela fonctionne. Je suis lue. Comprise, un peu. Rejetée, parfois, car j’ai une vraie voix, qui ne peut parler à tout le monde.
J’ai le temps de penser. Les inputs pour penser.
Je ne subis plus.
C’est le matin, jour de soleil, des petits pieds descendent des escaliers. J’ai cuisiné des biscuits, un gâteau. J’ai une famille, là, qui n’attend pas de moi plus que je ne peux être. En qui j’ai assez confiance pour ne pas me sentir obligée d’être plus que je ne peux être. Je deviens meilleure, plus heureuse, en n’ayant plus la terreur de ne pas être à la hauteur. D’être rejetée.
Quelques instants parfaits.
Bien sûr j’en ai vécus, déjà.
Bien sûr, les instants sombres ne disparaîtront jamais complètement.
Mais le calme, les ajustements, l’équilibre.
J’y crois.
Je veux que les fées existent. J’y crois.
J’y crois.

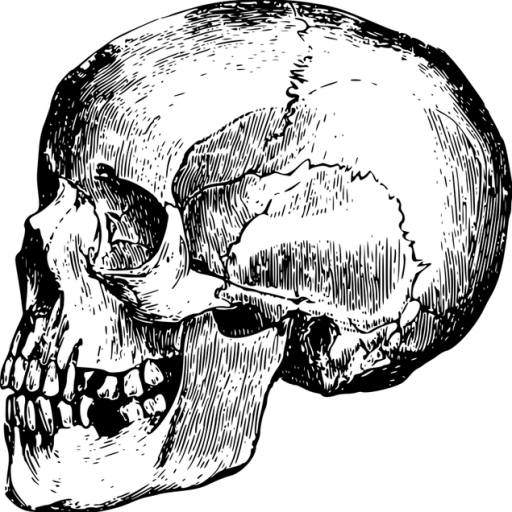




Laisser un commentaire