
Je renoncerai. Au bureau, au travail, au cadre facile et pragmatique qui me vient naturellement et m’est si difficile à supporter.
Je ne sais même pas pourquoi je reste encore.
Un crédit, un niveau de vie, certes.
Il faut bien payer les psys.
Un poids immense d’idées sur moi-même, d’obligations, de culpabilité. Le poids des autres que je m’inflige. La peur d’être rejetée, d’être vue comme faible ou sans volonté.
Je le suis, pourtant. Ou je voudrais l’être, même si j’ai depuis toujours eu la force absurde de me maintenir dans un cadre qui m’écrase et me dégoûte. Qui ne m’a rien fait, ce qui renforce pernicieusement ma culpabilité et ma détresse.
Comme si on devait quoi que ce soit aux idées.
Je ne leur en voudrais pas de me rejeter si je devenais un « parasite », une « feignasse », une de dépendante de l’aide publique.
Rejetterais-je quelqu’un pour ça ? Est-ce que je pense que c’est légitime ? Si c’est moi la feignasse, oui ! Si je devais être le support de quelqu’un pour qui travailler est devenu une souffrance… Je comprends parfaitement, et je suis jalouse, parce que j’en ai besoin aussi. Mais ce n’est pas un problème en soi. Simplement, j’aurais du mal à mettre les bouchées doubles en termes de motivation (même si deux fois zéro faisant zéro, c’est facile en fait…).
J’ai changé de travail tout récemment, afin de fuir l’ennui existentiel, la nausée le matin d’avoir à aller au travail, les crises de larmes dans les toilettes, les longues journées d’errance.
Bien sûr, ça n’a pas changé grand-chose.
Ma mère m’a dit une fois que sauter une classe m’a raccrochée à la réalité pendant environ trois mois. Je ne les aurai pas tenus cette fois. Pourtant je suis toujours là, comme toujours.
Avec le sentiment toujours plus présent de m’approcher de la fin, du craquage final et définitif, qui sera probablement bien moins radical.
J’ai toujours eu ce fantasme de tout plaquer, de claquer la porte, de me briser si fort que je finis internée, de dépasser cette ligne imaginaire qui commence au point de non-retour. C’est d’ailleurs l’histoire que j’ai raconté dans mon livre. Tout comme Sara, je rêve de monter dans ma voiture et de fuir la réalité matérielle de mon travail. Contrairement à elle, j’ai des choses – et surtout des gens – à perdre, et je doute vraiment d’aller mieux à l’autre bout du monde.
À neuf ans je rêvais de fuir ma vie à cheval, de vivre seule dans la forêt.
Aujourd’hui je rêve d’une vie alternative. De simplicité. De retraite.
La vie de mes tantes retraitées me fait rêver.
J’ai 26 ans, et je rêve d’être retraitée.
Que tout s’arrête, car ce tout est la contrainte, est le monstre qui vole neuf heures de ma vie et de mon cerveau chaque jour, qui colore en grisâtre mes soirées, qui donne au quotidien l’odeur de la poussière humide et la saveur d’un film en noir et blanc.
Je veux que tout s’arrête, pas pour ne rien faire, mais pour sentir que je n’ai rien à faire, que je ne suis forcée à rien. Que je peux lire, et me concentrer sur mon livre, car je n’ai pas à penser que mon temps de lecture ampute mon temps libre de façon presque inacceptable. Que je peux passer du temps à ne rien faire, à contempler les plis de ma pensée, à écrire, sans me flageller de ne pas être productive, de ne pas même écrire productive. Il faut écrire un article, un livre, quelque chose qui restera, qui me représente, qui justifie que j’emploie à bonne escient un temps libre qui me semble si raréfié.
La prochaine crise aura bien lieu. Elle ne remettra même pas tout en question.
C’est dommage…
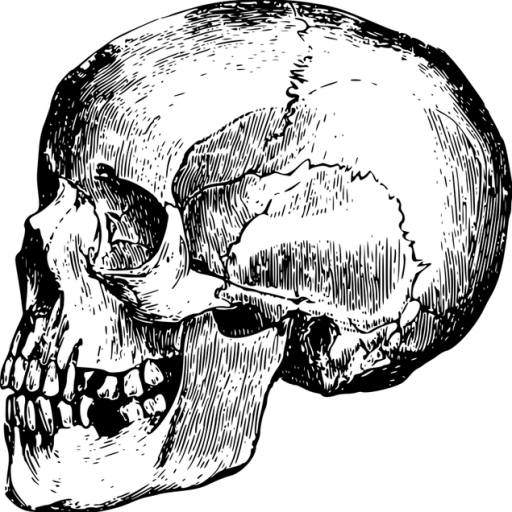




Laisser un commentaire